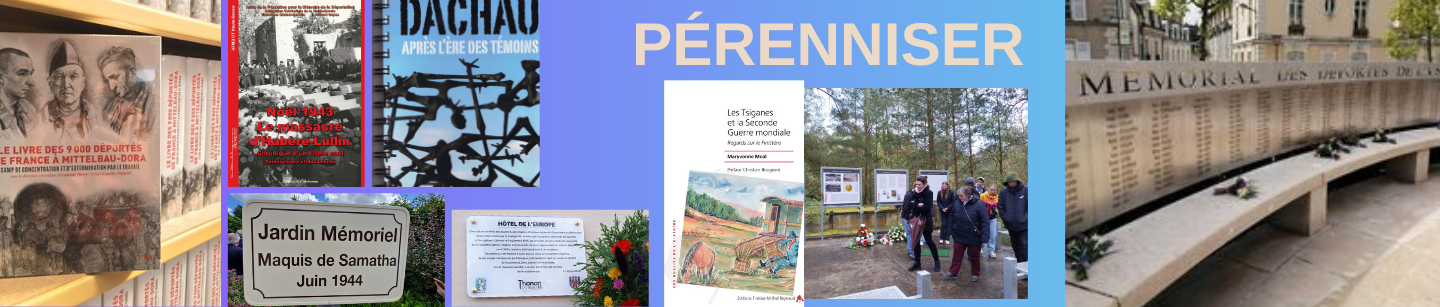28 janvier 1946 Marie Claude Vaillant-Couturier témoigne à Nuremberg
La décision de créer un tribunal militaire international fut prise durant l’été 1945 par les puissances alliées, c’est-à-dire les Etats-Unis, l’Union Sovétique et la Grande-Bretagne. Plusieurs représentants de chaque pays se sont réunis à Londres afin de décider quels criminels seront jugés et pour quels crimes. Pour les Américains les « crimes contre la paix » qui sont « la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression ou d’une guerre de violation de traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de quelconque des actes qui précèdent » étaient primordiaux alors que les autres donnaient plus d’importance aux « crimes de guerre » qui sont des « violations des lois et coutumes de la guerre » . En effet, les populations civiles ont beaucoup souffert des déportations et de mauvais traitements. Après deux semaines de débats, les délégués ont décidé que les accusés seront jugé pour « crime contre l’Humanité » qui est la « violation des règles de droit international (déportation, extermination, génocide) sanctionnée pénalement par les gouvernements des Etats » .
Les accusés ont été choisis parmi les figures du gouvernement hitlérien. Les Alliés constatèrent que les accusés ont presque tous eu une responsabilité plus ou moins grande dans le génocide des Juifs ; c’est pourquoi ils n’ont pas seulement été jugés pour « crime contre l’Humanité » mais aussi pour « actions contre les Juifs ».Le procès débuta le 20 novembre 1945 et se termina le 1er octobre 1946. Marie Claude Vaillant Couturier portera son témoignage le 28 janvier 1946. Pendant des mois, les procureurs et les avocats de la défense ont interrogé les accusés sur leur culpabilité, leur rôle dans le gouvernement nazi. Des preuves et des témoignages ont également été présentées aux juges. Tous les accusés, sauf Speer qui reconnu sa complicité morale, ont choisi la même tactique : ils n’étaient pas au courant de ce qui se passait dans les camps, rejetaient la culpabilité sur un ou l’autre de leurs « collègues » décédés ou disparus ; ou alors ils disaient avoir seulement obéi aux ordres du Führer. Après onze mois de procès les juges ont rendu leur verdict : 12 accusés seront pendus, 3 purgeront une peine de prison à perpétuité, 4 feront une peine de prison et 3 seront acquittés.
Tous ces procès ont été instruits pour montrer au monde que les horreurs perpétrées contre les Juifs ont été punies afin d’éviter que cela ne se reproduise dans le futur. Etant donné que les procès de la Deuxième Guerre mondiale ont été les premiers du genre, il faut leur accorder quelques erreurs. Mais les puissances alliées avaient dans l’idée de juger les accusés de manière individuelle d’après de nouvelles preuves plus adaptées aux événements survenus pendant la guerre. C’est ainsi que sont nées les notions de « crime de guerre », « crime contre la paix » et « crime contre l’humanité ».


Marie Claude Vaillant Couturier, interrogée par un journaliste du magazine "Regards "
Le journaliste : Pouvez-vous nous raconter la journée de Nuremberg, le jour de votre déposition ?
Marie Claude Vaillant Couturier : La Cour siège toute la matinée et l’après-midi jusqu’à cinq heures. J’ai l’impression que l’audition des témoins a apporté un peu de vie à ce procès sclérosé. Les accusés eux-mêmes s’endorment, en général, d’ennui.
Le journaliste : Avez-vous pu observer les réactions des accusés ?
Marie Claude Vaillant Couturier : Oui. J’ai eu la satisfaction de plonger mes yeux dans ceux de Goering. Et j’avais l’impression que, par ma bouche, c’étaient des millions de mortes qui l’accusaient.
Le journaliste : Où se trouvent, là-bas, les cellules des prisonniers ?
Marie Claude Vaillant Couturier : Elles sont séparées du Palais de justice par une grande cour plantée d’arbres.
Le journaliste : Et appréciez-vous la façon dont se déroulent les diverses phases de ce procès ?
Marie Claude Vaillant Couturier : Non, je le trouve trop long et je trouve aussi que le ton des avocats, à l’égard des témoins, n’est pas toujours celui qui conviendrait. Surtout quand on pense qu’ils sont allemands.
Le journaliste :Quelles ont été les réactions des assistants, pendant l’audition des témoins ?
Marie Claude Vaillant Couturier : Ils semblaient très impressionnés. Un journaliste tchèque m’a dit « Je suis les procès depuis vingt-cinq ans. Et jamais je n’ai été aussi ému qu’aujourd’hui. »
Le journaliste : Est-il exact qu’on ait opposé à votre parole celle de la Gestapo ?
Marie Claude Vaillant Couturier : Oui, quand j’ai dit que les SS avaient gazé 700 000 Juifs de Hongrie,pendant que j’étais à Auschwitz, l’avocat allemand m’a rétorqué que la Gestapo ne donnait le chiffre que de 350 000.
Le journaliste : Et qu’avez-vous répondu ?
Marie Claude Vaillant Couturier : J’ai répondu que je ne voulais pas discuter avec la Gestapo car j’étais payée pour savoir qu’elle disait toujours la vérité !... Mais, d’autre part, je trouve inconcevable qu’on mesure le crime au nombre des victimes et que l’on considère qu’il est moins criminel de n’avoir assassiné que 350 000 personnes.
Le journaliste : Pensez-vous que l’on n’oubliera pas ?
Marie Claude Vaillant Couturier : Nous qui sommes les survivantes, nous considérons que nous avons deux devoirs. Le premier, c’est de faire savoir au monde entier tout ce que nous avons vu et tout ce que nos compagnes ont souffert. Le deuxième, c’est de perpétuer le souvenir de toutes celles qui ne sont pas revenues et d’accomplir la tâche de reconstruction de la France à laquelle elles voulaient se consacrer
Lundi 28 janvier 1946
Quarante-quatrième journée - Audience du matin
M. Dubost : Avec l’autorisation du Tribunal, nous poursuivrons cette partie de l’exposé du cas français par l’audition d’un témoin qui a vécu pendant plus de trois ans dans les camps de concentration allemands.
(On introduit Madame Claude Vaillant-Couturier.)
Le Président : Quel est votre nom ? Voulez-vous vous lever, je vous prie ? Voulez-vous prêter serment en français ?
Madame Vaillant-Couturier (Mme V-C) : Claude Vaillant-Couturier.
Le Président : Répétez le serment avec moi : « Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. » Levez la main droite et dites : « Je le jure ».
Mme V-C : – Je le jure
Le Président : Asseyez-vous et parlez lentement. Vous vous appelez ?
Mme V-C : Vaillant-Couturier, Marie, née Claude Vogel.
M. Dubost : Votre nom actuel est Madame Vaillant-Couturier ?
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Vous êtes la veuve de M. Vaillant-Couturier.
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Vous êtes née à Paris le 3 novembre 1912 ?
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Vous êtes de nationalité française ?
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Née de nationalité française ?
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Parents eux-mêmes de nationalité française ?
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Vous êtes Député à l’Assemblée Constituante ?
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Vous êtes Chevalier de la Légion d’Honneur ?
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Et vous venez d’être décorée par le général Legentilhomme aux Invalides ?
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Vous avez été arrêtée et déportée. Pouvez-vous faire votre témoignage ?
Mme V-C : J’ai été arrêtée le 9 février 1942 par la Police française de Pétain, qui m’a remise aux autorités allemandes au bout de six semaines.
Je suis arrivée le 20 mars à la prison de la Santé, au quartier allemand.
J’ai été interrogée le 9 juin 1942. A la fin de mon interrogatoire, on a voulu me faire signer une déclaration qui n’était pas conforme à ce que j’avais dit. Comme j’ai refusé de la signer, l’officier qui m’interrogeait m’a menacée, et comme je lui ai dit que je ne craignais pas la mort ni d’être fusillée, il m’a dit : « Mais nous avons à notre disposition des moyens bien pires que de fusiller les gens pour les faire mourir », et l’interprète m’a dit : « Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Vous allez partir dans un camp de concentration allemand ; on n’en revient jamais. »
M. Dubost : Vous avez été conduite alors en prison ?
Mme V-C : J’ai été reconduite à la prison de la Santé, où j’ai été mise au secret.
J’ai cependant pu communiquer avec mes voisins par les canalisations et par les fenêtres. je me trouvais dans la cellule à côté de celles du philosophe Georges Politzer et du physicien Jacques Salomon, le gendre du professeur Langevin, l’élève de Curie, l’un des premiers qui ait étudié la désintégration atomique.
Georges Politzer m’a raconté par la canalisation que, pendant son interrogatoire, après l’avoir martyrisé, on lui a demandé s’il ne voulait pas écrire des brochures théoriques pour le national-socialisme. Comme il a refusé, on lui a dit qu’il ferait partie du premier train d’otages qui seraient fusillés.
Quant à Jacques Salomon, il a été également horriblement torturé, puis jeté au cachot, d’où il n’est sorti que le jour de son exécution pour dire au revoir à sa femme, également arrêtée, et à la Santé.
Hélène SalomonLangevin m’a raconté à Romainville, où je l’ai retrouvée en quittant la Santé, que lorsqu’elle s’était approchée de son mari pour l’embrasser, il avait poussé un gémissement et lui avait dit : « Je ne peux pas te prendre dans mes bras car je ne peux plus bouger »
Chaque fois que les détenus revenaient de l’interrogatoire, on entendait s’échapper par les fenêtres des gémissements et les détenus disaient qu’ils ne pouvaient plus se remuer. Durant le séjour de cinq mois que j’ai fait à la Santé, plusieurs fois on est venu chercher des otages pour les fusiller.
En quittant la Santé le 20 août 1942, j’ai été conduite au fort de Romainville, qui servait de camp d’otages. Là, j’ai assisté deux fois à des prises d’otages, le 21 août et le 22 septembre. Parmi les otages emmenés, il y avait les maris des femmes qui se trouvaient avec moi et qui sont parties pour Auschwitz ; la plupart y sont mortes. Ces femmes, pour la plupart, n’étaient arrêtées qu’à cause de l’activité de leur mari ; elles n’en avaient aucunes elles-mêmes.
M. Dubost : Vous êtes partie à Auschwitz à quel moment ?
Mme V-C : Je suis partie pour Auschwitz le 23 janvier et arrivée le 27.
M. Dubost : Vous faisiez partie d’un convoi ?
Mme V-C : Je faisais partie d’un convoi de 230 françaises. Il y avait parmi nous Danielle Casanova qui est morte à Auschwitz, Maï Politzer, qui est morte à Auschwitz, Hélène Salomon. Il y avait de vieilles femmes…
M. Dubost : Quelle était leur condition sociale ?
Mme V-C : Des intellectuelles, des institutrices, un peu de toutes les conditions sociales. Maï Politzer était médecin ; elle était la femme du philosophe Georges Politzer. Hélène Salomon est la femme du physicien Salomon ; c’est la fille du professeur Langevin. Danielle Casanova était chirurgien-dentiste et elle avait une grande activité parmi les femmes ; c’est elle qui a monté un mouvement de résistance parmi les femmes de prisonniers.
M. Dubost : Combien êtes-vous revenues sur 230 ?
Mme V-C : 49. Il y avait dans le transport, de vieilles femmes ; entre autres, je me souviens d’une de 67 ans, arrêtée pour avoir eu dans sa cuisine le fusil de chasse de son mari, qu’elle gardait en souvenir et qu’elle n’avait pas déclaré pour qu’on ne le lui prenne pas. Elle est morte au bout de 15 jours à Auschwitz.
Le Président : Vous avez dit que seulement 49 étaient revenues. Voulez-vous dire que seulement 49 sont arrivées à Auschwitz ?
Mme V-C : Non, seulement 49 sont revenues en France. Il y avait également des infirmes, en particulier une chanteuse qui n’avait qu’une qu’une jambe. Elle a été sélectionnée et gazée à Auschwitz.
Il y avait aussi une jeune fille de 16 ans, une élève de lycée, Claudine Guérin. Elle est morte également à Auschwitz.
Il y avait aussi deux femmes qui avaient été acquittées par le Tribunal militaire allemand ; elles s’appellent Marie Alonzo et Marie-Thérèse Fleuri ; elles sont mortes à Auschwitz.
Le voyage était extrêmement pénible, car nous étions 60 par wagon et l’on ne nous a pas distribué de nourriture ni de boissons pendant le trajet. Comme nous demandions aux arrêts aux soldats lorrains enrôlés dans la Wehrmacht qui nous gardaient si l’on arrivait bientôt, ils nous ont répondu : « Si vous saviez où vous allez, vous ne seriez pas pressées d’arriver ».
Nous sommes arrivées à Auschwitz au petit jour.
On a déplombé nos wagons et on nous a fait sortir à coups de crosses pour nous conduire au camp de Birkenau, qui est une dépendance du camp d’Auschwitz, dans une immense plaine qui, au mois de janvier, était glacée.
Nous avons fait le trajet en tirant nos bagages.
Nous sentions tellement qu’il y avait peu de chance d’en ressortir – car nous avions déjà rencontré les colonnes squelettiques qui se dirigeaient au travail – qu’en passant le porche, nous avons chanté la Marseillaise pour nous donner du courage.
On nous a conduites dans une grande barraque, puis à la désinfection.
Là, on nous a rasé la tête et on nous a tatoué sur l’avant-bras gauche le numéro de matricule.
Ensuite, on nous a mises dans une grande pièce pour prendre un bain de vapeur et une douche glacée.
Tout celà se passait en présence des SS, hommes et femmes, bien que nous soyons nues.
Après, on nous a remis des vêtements souillés et déchirés, une robe de coton et une jaquette pareille.
Comme ces opérations avaient pris plusieurs heures, nous voyions, des fenêtres du bloc où nous nous trouvions, le camp des hommes, et vers le soir, un orchestre s’est installé. Comme il neigeait, nous nous demandions pourquoi on faisait de la musique. A ce moment-là, les commandos de travail d’hommes sont rentrés. Derrière chaque commando, il y avait des hommes qui portaient des morts. Comme ils pouvaient à peine se traîner eux-mêmes, ils étaient relevés à coups de crosses ou à coups de bottes, chaque fois qu’ils s’affaissaient.
Après celà, nous avons été conduites dans le bloc où nous devions habiter. Il n’y avait pas de lits, mais des bat-flanc de 2 mètres sur 2 mètres, où nous étions couchées à 9, sans paillasse et sans couverture la première nuit. Nous sommes demeurées dans des blocs de ce genre pendant plusieurs mois.
Pendant toute la nuit, on ne pouvait pas dormir, parce que chaque fois que l’une des 9 se dérangeait – et comme elles étaient toutes malades, c’était sans arrêt – elle dérangeait toute la rangée.
A trois heures et demie du matin, les hurlements des surveillantes nous réveillaient, et, à coups de gourdins, on était chassé de son grabat pour partir à l’appel.
Rien au monde ne pouvait dispenser de l’appel, même les mourantes devaient y être traînées.
Là, nous restions en rangs par cinq jusqu’à ce que le jour se lève, c’est-à-dire 7 à 8 heures du matin en hiver, et, lorsqu’il y avait du brouillard, quelquefois jusqu’à midi. Puis, les commandos s’ébranlaient pour partir au travail.
M. Dubost : Je vous demande pardon, pouvez-vous décrire les scènes de l’appel ?
Mme V-C : Pour l’appel, on était mis en rangs, par cinq, puis nous attendions jusqu’au jour que les Aufseherinnen, c’est-à-dire les surveillantes allemandes en uniforme, viennent nous compter. Elles avaient des gourdins et elles distribuaient, au petit bonheur la chance, comme ça tombait, des coups. Nous avons une compagne, Germaine Renaud, institutrice à Azay-le-Rideau, qui a eu le crâne fendu devant mes yeux par un coup de gourdin, durant l’appel.
Le travail à Auschwitz consistait en déblaiements de maisons démolies, constructions de routes et surtout assainissement des marais. C’était de beaucoup le travail le plus dur, puisqu’on était toute la journée les pieds dans l’eau et qu’il y avait danger d’enlisement. Il arrivait constamment qu’on soit obligé de retirer une camarade qui s’était enfoncée parfois jusqu’à la ceinture. Durant tout le travail, les SS hommes et femmes qui nous surveillaient nous battaient à coups de gourdins et lançaient sur nous leurs chiens. Nombreuses sont les camarades qui ont eu les jambes déchirées par les chiens. Il m’est même arrivée de voir une femme déchirée et mourir sous mes yeux, alors que le SS Tauber excitait son chien contre elle et ricanait à ce spectacle.
Les causes de la mortalité étaient extrêmement nombreuses. Il y avait d’abord le manque d’hygiène total. Lorsque nous sommes arrivées à Auschwitz, pour 12 000 détenues, il y avait un seul robinet d’eau non potable, qui coulait par intermittence. Comme ce robinet était dans les lavabos allemands, on ne pouvait y accéder qu’en passant par une garde de détenues allemandes de droit commun, qui nous battaient effroyablement. Il était donc presque impossible de se laver ou de laver son linge. Nous sommes restées pendant plus de trois mois sans jamais changer de linge ; quand il y avait de la neige, nous en faisions fondre pour pouvoir nous laver. plus tard, au printemps, quand nous allions au travail, dans la même flaque d’eau sur le bord de la route, nous buvions, nous lavions notre chemise ou notre culotte. Nous nous lavions à tour de rôle dans cette eau polluée. Les compagnes mouraient de soif, car on ne distribuait que deux fois par jour un demi-quart de tisane.
M. Dubost : Voulez-vous préciser en quoi consistait l’un des appels du début du mois de février ?
Mme V-C : Il y a eu le 5 février ce que l’on appelait un appel général.
M. Dubost : Le 5 février de quelle année ?
Mme V-C : 1 943. A 3 heures et demie, tout le camp…
M. Dubost : Le matin ?
Mme V-C : Le matin. A 3 heures et demie tout le camp a été réveillé et envoyé dans la plaine, alors que d’habitude l’appel se faisait à 3 heures et demie, mais à l’intérieur du camp.
Nous sommes restées, dans cette plaine, devant le camp, jusqu’à 5 heures du soir, sous la neige, sans recevoir de nourriture, puis, lorsque le signal a été donné, nous devions passer la porte une à une, et l’on donnait un coup de gourdin dans le dos, à chaque détenue, en passant, pour la faire courir.
Celle qui ne pouvait pas courir, parce qu’elle était trop vieille ou trop malade, était happée par un crochet et conduite au bloc 25, le bloc d’attente pour les gaz.
Ce jour-là, dix Françaises dans notre transport ont été happées ainsi et conduites au bloc 25.
Lorsque toutes les détenues furent rentrées dans le camp, une colonne, dont je faisais partie, a été formée pour aller relever dans la plaine les mortes qui jonchaient le sol comme sur un champ de bataille. Nous avons transporté dans la cour du bloc 25 les mortes et les mourantes, sans faire de distinction ; elles sont restées entassées ainsi. Ce bloc 25, qui était l’antichambre de la chambre à gaz – si l’on peut dire – je le connais bien, car, à cette époque, nous avions été transférées au bloc 26 et nos fenêtres donnaient sur la cour du 25. On voyait les tas de cadavres, empilés dans la cour, et, de temps en temps, une main ou une tête bougeait parmi ces cadavres, essayant de se dégager : c’était une mourante qui essayait de sortir de là pour vivre. La mortalité de ce bloc était encore plus effroyable qu’ailleurs, car, comme c’étaient des condamnées à mort, on ne leur donnait à manger et à boire que s’il restait des bidons à la cuisine, c’est-à-dire que souvent elles restaient plusieurs jours sans une goutte d’eau.
Un jour, une de nos camarades, Annette Epaux, une belle jeune femme de trente ans, passant devant le bloc, eut pitié de ces femmes qui criaient du matin au soir, dans toutes les langues : « A boire, à boire, de l’eau ». Elle est rentrée dans notre bloc chercher un peu de tisane mais, au moment où elle passait par le grillage de la fenêtre, la Aufseherin l’a vue, l’a prise par le collet et l’a jetée au bloc 25. Toute ma vie, je me souviendrai d’Annette Epaux. deux jours après, montée sur le camion qui se dirigeait vers la chambre à gaz, elle tenait contre elle une autre Française, la vieille Line Porcher, et au moment où le camion s’est ébranlé, elle nous a crié : « Pensez à mon petit garçon, si vous rentrez en France ». Puis elles se sont mises à chanter la Marseillaise. Dans le bloc 25, dans la cour, on voyait les rats, gros comme des chats, courir et ronger les cadavres et même s’attaquer aux mourantes, qui n’avaient plus la force de s’en débarrasser.
Une autre cause de mortalité et d’épidémie était le fait qu’on nous donnait à manger dans de grandes gamelles rouges qui étaient seulement passées à l’eau froide après chaque repas. Comme toutes les femmes étaient malades, et qu’elles n’avaient pas la force durant la nuit de se rendre à la tranchée qui servait de lieux d’aisance et dont l’abord était indescriptible, elles utilisaient ces gamelles pour un usage auquel elles n’étaient pas destinées. Le lendemain, on ramassait ces gamelles, on les portait sur un tas d’ordures et, dans la journée, une autre équipe venait les récupérer, les passait à l’eau froide, et les remettait en circulation.
Une autre cause de mort était la question des chaussures. dans cette neige et cette boue de Pologne, les chaussures de cuir étaient complètement abîmées au bout de huit à quinze jours. On avait donc les pieds gelés et des plaies aux pieds. Il fallait coucher sur ses souliers boueux de peur qu’on ne les vole, et presque chaque nuit, au moment de se lever pour l’appel, on entendait des cris d’angoisse : » On m’a volé mes chaussures « Il fallait alors attendre que tous les blocs soient vidés pour chercher sous les cadres les laissés-pourcompte. C’étaient parfois deux souliers d’un même pied ou un soulier et un sabot. Celà permettait de faire l’appel, mais pour le travail, c’était une torture supplémentaire puisque cela occasionnait des plaies aux jambes qui, à cause du manque de soins, s’envenimaient rapidement. Nombreuses sont les compagnes qui sont entrées au « Revier » pour des plaies aux jambes et qui n’en sont jamais ressorties.
M. Dubost : Que faisait-on aux internées qui se présentaient à l’appel sans chaussures ?
Mme V-C : Les internées Juives qui allaient à l’appel sans chaussures étaient immédiatement conduites au bloc 25.
M. Dubost : On les gazait donc ?
Mme V-C : On les gazait pour n’importe quoi. Leur situation du reste était absolument effroyable. Alors que nous étions entassées à 800 dans des blocs et que nous pouvions à peine nous remuer, elles étaient dans des blocs de dimensions semblables, à 1 500, c’est-à-dire qu’un grand nombre ne pouvait pas dormir la nuit, ou même s’étendre.
M. Dubost : Pouvez-vous parler du Revier ?
Mme V-C : Pour arriver au Revier, il fallait d’abord faire l’appel. Quel que soit l’état…
M. Dubost : Voulez-vous préciser ce qu’était le Revier dans le camp ?
Mme V-C : Le Revier était les blocs où l’on mettait les malades. On ne peut pas donner à cet endroit le nom d’hôpital, car cela ne correspond pas du tout à l’idée qu’on se fait d’un hôpital. Pour y aller, il fallait d’abord obtenir l’autorisation du chef de bloc, qui la donnait très rarement. Quand enfin on l’avait obtenue, on était conduit en colonne devant l’infirmerie où, par tous les temps, qu’il neige, ou qu’il pleuve, même avec 40° de fièvre, on devait attendre devant la porte de l’infirmerie, avant d’avoir pu y pénétrer. Du reste, même de faire la queue devant l’infirmerie était dangereux car, lorsque cette queue était trop grande, le SS passait, ramassait toutes les femmes qui attendaient et les conduisait directement au bloc 25.
M. Dubost : C’est-à-dire à la chambre à gaz ?
Mme V-C : C’est-à-dire à la chambre à gaz.
C’est pourquoi, très souvent les femmes préféraient ne pas se présenter au Revier, et elles mouraient au travail ou à l’appel. Après l’appel du soir, en hiver, quotidiennement on relevait des mortes qui avaient roulé dans les fossés. Le seul intérêt du Revier, c’est que, comme on était couché, on était dispensé de l’appel, mais on était couché dans des conditions effroyables, dans des lits de moins d’un mètre de large, à quatre, avec des maladies différentes, ce qui faisait que celles, qui étaient entrées pour des plaies aux jambes, attrapaient la dysenterie ou le typhus de leur voisine. Les paillasses étaient souillées, on ne les changeait que quand elles étaient complètement pourries. Les couvertures étaient si pleines de poux qu’on les voyait grouiller comme des fourmis.
Une de mes compagnes, Marguerite Corringer, me racontait que, pendant son typhus, elle ne pouvait pas dormir toute la nuit à cause des poux ; elle passait sa nuit à secouer sa couverture sur un papier, à vider les poux dans un récipient auprès de son lit, et ainsi pendant des heures. Il n’y avait pour ainsi dire pas de médicaments ; on laissait donc les malades couchées, sans soins, sans hygiène, sans les laver. On laissait les mortes pendant plusieurs heures couchées avec les malades, puis quand enfin on s’apercevait de leur présence, on les balançait simplement hors du lit et on les conduisait devant le bloc. Là, la colonne des porteuses de mortes venait les chercher sur de petits brancards, d’où la tête et les jambes pendaient. Du matin au soir, les porteuses de mortes faisaient le trajet entre le Revier et la morgue. Pendant les grandes épidémies de typhus des hivers 1943 et 1944, les brancards ont été remplacés par des chariots, car il y avait trop de mortes. Il y a eu, pendant ces périodes d’épidémie, de 200 à 350 mortes par jour.
M. Dubost : Combien mourait-il de gens à ce moment-là ?
Mme V-C : Pendant les grandes épidémies de typhus des hivers 1943-1944, de 200 à 350 suivant les jours.
M. Dubost : Le Revier était-il ouvert à toutes les internées ?
Mme V-C : Non, quand nous sommes arrivées, les Juives n’avaient pas le droit d’y aller, elles étaient directement conduites à la chambre à gaz.
Monsieur Dubost : Voulez-vous parler de la désinfection des blocs, s’il vous plaît ?
Mme V-C : De temps en temps, étant donné les tas de saletés qui occasionnaient des poux et par conséquent tant d’épidémies, on désinfectait les blocs en les gazant, mais ces désinfections causaient également un très grand nombre de morts parce que, pendant qu’on gazait le bloc, les prisonnières étaient conduites aux douches, puis on leur retirait leurs vêtements, qu’on passait à l’étuve… On les laissait toutes nues dehors attendre que les vêtements ressortent de l’étuve et on leur redonnait mouillés. On envoyait même les malades, quand elles pouvaient se tenir sur leurs jambes, aux douches. Il est évident qu’un très grand nombre mouraient en cours de route. Celles qui ne pouvaient pas bouger, étaient lavées toutes dans la même baignoire pendant la désinfection.
M. Dubost : Comment étiez-vous nourries ?
Mme V-C : Nous recevions 200 grammes de pain, trois quarts de litre ou un demi-litre – suivant les cas – de soupe au rutabaga et quelques grammes de margarine ou une rondelle de saucisson le soir. Cela pour le jour.
M. Dubost : Quel que soit le travail qui était exigé des internées ?
Mme V-C : Quel que soit le travail qui était exigé de l’internée. Certaines qui travaillaient à l’usine de l’« Union », une fabrique de munitions où elles faisaient des grenades et des obus, recevaient ce qu’on appelait un « zulage », c’est-à-dire un supplément, quand la norme était atteinte. Ces détenues faisaient, comme nous, l’appel le matin et le soir et elles étaient au travail 12 heures dans leur usine. Elles rentraient au camp après le travail et faisaient le trajet aller et retour à pied.
M. Dubost : Qu’était cette usine de l’« Union » ?
Mme V-C : C’était une fabrique de munitions. Je ne sais pas à quelle société elle appartenait. Cela s’appelait l’« Union ».
M. Dubost : C’était la seule usine ?
Mme V-C : Non, il y avait également une grande usine à Buna, mais comme je n’y ai pas travaillé, je ne sais pas ce qu’on y faisait. Les détenues qui étaient prises pour Buna ne revenaient plus dans notre camp.
M. Dubost : Voulez-vous parler des expériences si vous en avez été témoin ?
Mme V-C : En ce qui concerne les expériences, j’ai vu dans le Revier, car j’étais employée au Revier, la file des jeunes Juives de Salonique qui attendaient, devant la salle des rayons, pour la stérilisation. Je sais, par ailleurs, qu’on opérait également par castration dans le camp des hommes. En ce qui concerne les expériences faites sur des femmes, je suis au courant parce que mon amie, la doctoresse Hautval, de Montbéliard, qui est rentrée en France, a travaillé plusieurs mois dans ce bloc pour soigner les malades, mais elle a toujours refusé de participer aux expériences. On stérilisait les femmes, soit par piqûres, soit par opérations, ou également par rayons. J’ai vu et connu plusieurs femmes qui avaient été stérilisées. Il y avait parmi les opérées une forte mortalité. Quatorze Juives de France qui avaient refusé de se laisser stériliser ont été envoyées dans un commando de Strafarbeit, c’est-à-dire punition de travail.
M. Dubost : Revenait-on de ces commandos ?
Mme V-C : Rarement, tout à fait exceptionnellement.
M. Dubost : Quel était le but poursuivi par les SS ?
Mme V-C : Les stérilisations, ils ne s’en cachaient pas ; ils disaient qu’ils essayaient de trouver la meilleure méthode de stérilisation pour pouvoir remplacer, dans les pays occupés, la population autochtone par les Allemands, au bout d’une génération, une fois qu’ils auraient utilisé les habitants comme esclaves pour travailler pour eux.
M. Dubost : Au Revier, avez-vous vu des femmes enceintes ?
Mme V-C : Oui. Les femmes juives, quand elles arrivaient enceintes de peu de mois, on les faisait avorter. Quand la grossesse était près de la fin, après l’accouchement, on noyait les bébés dans un seau d’eau. Je sais cela parce que je travaillais au Revier, et que la préposée à ce travail était une sage-femme allemande, détenue de droit commun pour avoir pratiqué des avortements. Au bout d’un certain temps, un autre médecin est arrivé et, pendant deux mois, on n’a pas tué de bébés juifs. Mais, un beau jour, un ordre est arrivé de Berlin disant qu’il fallait de nouveau les supprimer. Alors, les mères et leurs bébés ont été appelées à l’infirmerie, elles sont montées en camion et on les a conduites aux gaz.
M. Dubost : Pourquoi dites-vous qu’un ordre est arrivé de Berlin ?
Mme V-C : Parce que je connaissais les détenues qui travaillaient au secrétariat des SS, en particulier, une Slovaque, nommée Herta Roth, qui travaille à l’heure actuelle à l’UNRRA à Bratislava.
M. Dubost : C’est elle qui vous l’a dit ?
Mme V-C : Oui. Et d’autre part, je connaissais également les hommes qui travaillaient au commando des gaz.
M. Dubost : Vous venez de parler des mères juives, y avait-il d’autres mères dans votre camp ?
Mme V-C : Oui, en principe, les femmes non juives accouchaient et on ne leur enlevait pas leurs bébés, mais, étant donné les conditions effroyables du camp, les bébés dépassaient rarement quatre à cinq semaines. Il y avait le bloc où se trouvaient les mères polonaises et russes. Un jour, les mère russes ayant été accusées de faire trop de bruit, on leur a fait faire l’appel toute la journée devant le bloc, toutes nues avec leurs bébés dans leurs bras.
M. Dubost : Quel était le régime disciplinaire du camp ? Qui assurait la surveillance et la discipline ? Quelles étaient les sanctions ?
Mme V-C : En général, les SS économisaient beaucoup de personnel à eux en employant des détenues pour la surveillance du camp. Ils ne faisaient que superviser. Ces détenues étaient prises parmi les filles de droit commun ou des filles publiques allemandes, et quelquefois d’autres nations, mais en majorité des Allemandes. On arrivait par la corruption et la délation, la terreur, à les transformer en bêtes humaines, et les détenues ont autant à s’en plaindre que des SS eux-mêmes. Elles frappaient autant que frappaient les SS et, en ce qui
concerne les SS, les hommes se conduisaient comme les femmes et les femmes étaient aussi sauvages que les hommes. Il n’y a pas de différence. Le système employé par les SS pour avilir les êtres humains au maximum en les terrorisant, et, par la terreur, en leur faisant faire des actes qui devaient les faire rougir eux-mêmes, arrivait à faire qu’ils ne soient plus des êtres humains. Et c’était cela qu’ils recherchaient ; il fallait énormément de courage pour résister à cette ambiance de terreur et de corruption.
M. Dubost : Qui distribuait les punitions
Mme V-C : Les chefs SS, les hommes et les femmes.
M. Dubost : En quoi consistaient les punitions ?
Mme V-C : En mauvais traitements corporels, en particulier, une des punitions les plus classiques était 50 coups de bâton sur les reins. Ces coups de bâton étaient donnés par une machine que j’ai vue ; c’était un système de balancements qui était manipulé par un SS. Il y avait aussi des appels interminables jour et nuit ou bien de la gymnastique ; il fallait se mettre à plat ventre, se relever, se mettre à plat ventre, se relever, pendant des heures, et quand on tombait, on était assommé de coups et transporté au bloc 25.
M. Dubost : Comment se comportaient les SS à l’égard des femmes ? Et les femmes SS ?
Mme V-C : Il y avait à Auschwitz une maison de tolérance pour les SS et également pour les détenus, fonctionnaires hommes, qu’on appelait des « Kapo ». D’autre part, quand les SS avaient besoin de domestiques, ils venaient, accompagnés de l’Obersaufseherin, c’est-à-dire la commandante femme du camp, choisir pendant la désinfection, et ils désignaient une petite jeune fille que l’Oberaufseherin faisait sortir des rangs. Ils la scrutaient, faisaient des plaisanteries sur son physique et, si elle était jolie et leur plaisait, ils l’engageaient comme bonne avec le consentement de l’Oberaufseherin qui leur disait qu’elle leur devait une obéissance absolue, quoi qu’ils lui demandent.
M. Dubost : Pourquoi venaient-ils pendant le désinfection ?
Mme V-C : Parce que pendant la désinfection, les femmes étaient nues.
M. Dubost : Ce système de démoralisation et de corruption étaitil exceptionnel ?
Mme V-C : Non, dans tous les camps où j’ai passé, le système était le même ; j’ai parlé à des détenues venues de camps où je n’avais pas été moi-même, et c’est toujours la même chose. Le système est exactement le même dans n’importe quel camp. Cependant il y a des variantes. Auschwitz, je crois, était l’un des plus durs, mais j’ai été ensuite à Ravensbrück ; là aussi, il y avait une maison de tolérance et là aussi on recrutait parmi les détenues.
M. Dubost : Selon vous, tout a été mis en oeuvre alors pour les faire déchoir à leurs propres yeux ?
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Que savez-vous du transport des Juifs, qui est arrivé presque en même temps que vous, venant de Romainville ?
Mme V-C : Quand nous avons quitté Romainville, on avait laissé sur place les Juives qui étaient à Romainville en même temps que nous ; elles ont été dirigées vers Drancy et sont arrivées à Auschwitz où nous les avons retrouvées trois semaines plus tard, trois semaines après nous.
Sur 1 200 qu’elles étaient, il n’en est entré dans le camp que 125, les autres ont été dirigées sur les gaz tout de suite. Sur ces 125, au bout d’un mois, il n’en restait plus une seule.
Les transports se pratiquaient de la manière suivante au début, quand nous sommes arrivés : quand un convoi de Juifs arrivait, on sélectionnait : d’abord les vieillards, les vieilles femmes, les mères et les enfants qu’on faisait monter en camions, ainsi que les malades ou ceux qui paraissaient de constitution faible. On ne prenait que les jeunes femmes et jeunes filles, et les jeunes gens qu’on envoyait au camp des hommes. Il arrivait, en général, sur un transport de 1 000 à 1 500, qu’il en entrait rarement plus de 250 – et c’est tout à fait un maximum – dans le camp. Le reste était directement dirigé aux gaz. A cette sélection également, on choisissait les femmes en bonne santé, entre 20 et 30 ans, qu’on envoyait au bloc des expériences, et les jeunes filles et les femmes un peu plus agées ou celles qui n’avaient pas été choisies dans ce but étaient envoyées au camp où elles étaient, comme nous, rasées et tatouées. Il y a eu, également pendant le printemps 1944, un bloc de jumeaux. C’était la période où sont arrivés d’immenses transports de Juifs hongrois : 700 000 environ. Le Dr Mengele, qui faisait des expériences, gardait de tous les transports, les enfants jumeaux et en général les jumeaux, quel que soit leur âge, pourvu qu’ils soient là tous les deux. Alors, dans ce bloc, il y a avait des bébés et des adultes, par terre. Je ne sais pas, en dehors des prises de sang et des mesures, je ne sais pas ce qu’on leur faisait.
M. Dubost : Etes-vous témoin direct de la sélection à l’arrivée des convois ?
Mme V-C : Oui, parce que quand nous avons travaillé au bloc de la couture en 1944, notre bloc où nous habitions était en face de l’arrivée du train. On avait perfectionné le système : au lieu de faire la sélection à la halte d’arrivée, une voie de garage menait le train presque jusqu’à la chambre à gaz et l’arrêt, c’est-à-dire à 100 mètres de la chambre à gaz, était juste devant notre bloc, mais naturellement, séparé par deux rangées de fil de fer barbelé. Nous voyions donc les wagons déplombés, les soldats sortir les hommes, les femmes et les enfants des wagons, et on assistait aux scènes déchirantes des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d’abandonner leurs jeunes filles, puisqu’elles entraient dans le camp, tandis que les mères et les enfants étaient dirigés vers la chambre à gaz. Tous ces gens-là ignoraient le sort qui leur était réservé. Ils étaient seulement désemparés parce qu’on les séparait les uns des autres, mais ils ignoraient qu’ils allaient à la mort.
Pour rendre l’accueil plus agréable, à cette époque, c’est-à-dire en juin, juillet 1944, un orchestre composé de détenues, toutes jeunes et jolies, habillées de petites blouses blanches et de jupes bleu marine, jouait, pendant la sélection à l’arrivée des trains, des airs gais comme la Veuve Joyeuse, la Barcarolle, des Contes d’Hoffmann, etc. Alors, on leur disait que c’était un camp de travail, et comme ils n’entraient pas dans le camp, il ne voyaient que la petite plateforme entourée de verdure où se trouvait l’orchestre. Evidemment, ils ne pouvaient pas se rendre compte de ce qui les attendait. Ceux qui étaient sélectionnés pour les gaz, c’est-à-dire les vieillards, les enfants et les mères, étaient conduits dans un bâtiment en briques rouges.
M. Dubost : Ceux-là n’étaient pas immatriculés ?
Mme V-C : Non.
M. Dubost : Ils n’étaient pas tatoués ?
Mme V-C : Non. Ils n’étaient même pas comptés.
M. Dubost : Vous avez été tatouée ?
Mme V-C : Oui. Voyez. (Le témoin montre son bras).
Ils étaient conduits dans un bâtiment en briques rouges qui portait les lettre « Bad », c’est-à-dire « bains ». Là, au début, on les faisait se déshabiller, et on leur donnait une serviette de toilette avant de les faire entrer dans la soi-disant salle de douches. Par la suite, à l’époque des grands transports de Hongrie, on n’avait plus le temps de jouer ou de simuler. On les déshabillait brutalement et je sais ces détails car j’ai connu une petite Juive de France, qui habitait avec sa famille Place de la République…
M. Dubost : A Paris ?
Mme V-C : A Paris… qu’on appelait la petite Marie et qui était la seule survivante d’une famille de neuf. Sa mère et ses sept frères et sœurs avaient été gazés à l’arrivée. Lorsque je l’ai connue, elle était employée pour déshabiller les bébés avant la chambre à gaz. On faisait pénétrer les gens, une fois déshabillés, dans une pièce qui ressemblait à une salle de douches, et par un orifice dans le plafond, on lançait les capsules de gaz. Un SS regardait par un hublot l’effet produit. Au bout de cinq à sept minutes, lorsque le gaz avait fait son œuvre, il donnait le signal pour qu’on ouvre les portes. Des hommes avec des masques à gaz – ces hommes étaient des détenus - pénétraient dans la salle et retiraient les corps. Ils nous racontaient que les détenus devaient souffrir avant de mourir, car ils étaient agrippés les uns aux autres en grappes et on avait beaucoup de mal à les séparer. Après cela, une équipe passaitpour arracher les dents en or et les dentiers. Et encore une fois, quand les corps étaient réduits en cendres, on passait encore au tamis pour essayer de récupérer l’or.
Il y avait à Auschwitz huit fours crématoires. Mais à partir de 1944, ce n’était pas suffisant. Les SS ont fait creuser par les détenus de grandes fosses dans lesquelles ils mettaient des branchages arrosés d’essence qu’ils enflammaient. Ils jetaient les corps dans ces fosses. de notre bloc, nous voyions, à peu près trois quarts d’heure ou une heure après l’arrivée d’un transport, sortir les grandes flammes du four crématoire et le ciel s’embraser par les fosses.
Une nuit, nous avons été réveillées par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin, par les hommes qui travaillaient au Sonderkommando (le commando des gaz) que la veille, n’ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans la fournaise.
M. Dubost : Pouvez-vous parler des sélections, s’il vous plaît, qui étaient faites à l’entrée de l’hiver ?
Mme V-C : Chaque année, vers la fin de l’automne, on faisait dans les Revier de grandes sélections. Le système semblait être le suivant. (Je dis cela parce que, sur le temps que j’ai passé à Auschwitz, j’ai pu en faire la constatation, et d’autres qui sont restées plus longtemps que moi ont fait la même constatation).
Au printemps, à travers toute l’Europe, on raflait des hommes et des femmes, qu’on envoyait à Auschwitz. On ne gardait que ceux qui étaient assez forts pour travailler tout l’été. Pendant cette période, naturellement, il en mourait tous les jours. Mais les plus robustes, qui arrivaient à tenir six mois, étaient au bout de ce temps si épuisés qu’ils entraient à leur tour au Revier. C’est à ce moment-là qu’on faisait de grandes sélections, en automne, pour ne pas avoir à nourrir pendant l’hiver des bouches inutiles.
Toutes les femmes qui étaient trop maigres étaient envoyées au gaz, toutes celles qui avaient des maladies un peu longues. Mais on gazait les Juives pour presque rien : par exemple, on a gazé celles du bloc de la gale, alors que chacun sait que la gale se guérit en trois jours si on la soigne. Je me souviens du bloc des convalescentes du typhus où, sur 500 malades, on en a envoyé 450 aux gaz.
Pendant Noël 1944, non 1943, à Noël 1943, alors que nous étions en quarantaine, nous avons vu, car nous étions en face du bloc 25, amener les femmes toutes nues dans le bloc. Ensuite, on faisait venir les camions, des camions non bâchés sur lesquels on empilait des femmes nues, autant que les camions pouvaient en contenir, et puis, chaque fois que le camion s’ébranlait, le fameux Hessler – qui a été au procès de Luneburg un des condamnés – courait derrière le camion, et, avec sa trique, il battait à coups redoublés ces femmes nues qui s’en allaient à la mort. Elles savaient qu’elles partaient aux gaz, alors elles essayaient de s’échapper. On les massacrait. Elles essayaient de sauter du camion, et nous, de notre bloc, nous voyions passer le camion, et nous entendions la lugubre clameur de toutes ces femmes qui partaient, en sachant qu’elles devaient être gazées, et beaucoup d’entre elles auraient très bien pu vivre, elles n’avaient que la gale, ou simplement un peu trop de sousalimentations.
M. Dubost : Vous nous avez dit, Madame, tout à l’heure, que les déportés étaient, dès leur descente du train, et sans être comptés même, envoyés à la chambre à gaz. Que devenaient leurs vêtements, leurs bagages ?
Mme V-C : Quand les Juifs arrivaient – parce que pour les non Juifs ils devaient porter eux-mêmes leurs bagages et étaient rangés dans des blocs à part – ils devaient tout laisser sur le quai à l’arrivée, ils étaient déshabillés avant d’entrer et leurs habits, ainsi que tout ce qu’ils avaient apporté et laissé sur le quai, étaient transportés dans de grandes baraques, et triés par le commando qu’on appelait « Canada ». Là, on faisait des triages et tout était expédié vers l’Allemagne : les bijoux, les manteaux de fourrure, etc… Comme on envoyait à Auschwitz des Juives avec toute leur famille, en leur disant que ce serait une sorte de ghetto et qu’il fallait qu’elles emportent tout ce qu’elles possédaient, elles amenaient donc des richesses considérables. Je me souviens, en ce qui concerne les Juives de Salonique, quand elles sont arrivées, on leur a donné une carte postale avec inscrit dessus comme lieu d’expédition : Waldsee, lieu qui n’existait pas, et un texte imprimé, qu’elles devaient envoyer à leur famille, disant : « Nous sommes très bien ici, il y a du travail, on est bien traité, nous attendons votre arrivée ». J’ai vu moi-même les cartes en question, et les Schreiberinnen, c’est-àdire les secrétaires de bloc, avaient l’ordre de les distribuer parmi les détenues, pour qu’elles les envoient à leurs familles, et je sais qu’à la suite de cela des familles se sont présentées. Je ne connais cette histoire que pour la Grèce. Je ne sais pas si elle s’est pratiquée ailleurs, mais, en tout cas, pour la Grèce (également pour la Slovaquie), des familles se sont présentées au bureau de recrutement, à Salonique, pour aller rejoindre les leurs, et je me souviens d’un professeur de lettres de Salonique qui a vu avec horreur arriver son père.
M. Dubost : Voulez-vous parler des camps de Tziganes ?
Mme V-C : Il y avait à côté de notre camp, de l’autre côté des fils de fer barbelés séparés par trois mètres, deux camps, un camp de Tziganes qui a été, en 1944, vers le mois d’août, entièrement gazé. C’était des Tziganes de toute l’Europe, y compris l’Allemagne. Egalement de l’autre côté, il y avait ce que l’on appelait le « camp familial ». C’étaient des Juifs de Theresienstatd, du ghetto de Theresienstatd, qui avaient été conduits là-bas, et, contrairement à nous, ils n’étaient ni tatoués, ni rasés, on ne leur enlevait pas leurs vêtements, ils ne travaillaient pas. Ils ont vécu comme cela six mois, et au bout de six mois, on a gazé tout le « camp familial ». Cela représentait à peu près 6 000 ou 7 000 Juifs et, quelques jours après, d’autres grands transports sont arrivés de Theresienstatd également, avec des familles, et, au bout de six mois également, elles ont été gazées comme les premières.
M. Dubost : Voudriez-vous, Madame, donner quelques précisions sur ce que vous avez vu lorsque vous étiez sur le point de quitter ce camp, et dans quelles conditions vous l’avez quitté ?
Mme V-C : Nous avons été mises en quarantaine avant de quitter Auschwitz.
M. Dubost : A quelle époque était-ce ?
Mme V-C : Nous avons été dix mois en quarantaine, du 15 juillet 1943, oui, jusqu’en mai 1944, et puis nous sommes retournées pendant deux mois dans le camp et ensuite, nous sommes parties pour Ravensbrück.
M. Dubost : C’étaient toutes les Française survivantes de votre convoi ?
Mme V-C : Oui, toutes les Françaises survivantes de notre convoi. Nous avons appris, par les Juives arrivées de France vers juillet 1944, qu’une grande campagne avait été faite à la radio de Londres où l’on parlait de notre transport, en citant Maï Politzer, Danielle Casanova, Hélène Salomon-Langevin, et moi-même, et à la suite de cela, nous savons que des ordres ont été donnés à Berlin d’effectuer le transport de Françaises dans de meilleures conditions. Nous avons donc été en quarantaine. C’était un bloc situé en face du camp, à l’extérieur des fils de fer barbelés. Je dois dire que c’est à cette quarantaine que les survivantes doivent la vie, car au bout de quatre mois nous n’étions plus que 52.
Il est donc certain que nous n’aurions pas survécu dix-huit mois de cette vie, si nous n’avions pas eu ces dix mois de quarantaine. Cette quarantaine était faite parce que le typhus exanthématique régnait à Auschwitz. On ne pouvait quitter le camp pour être libérée ou transférée dans un autre camp, ou pour aller au Tribunal, qu’après avoir passé quinze jours en quarantaine, ces quinze jours étant la durée d’incubation du typhus exanthématique. Aussi, dès que les papiers arrivaient, annonçant qu’une détenue serait probablement libérée, on l’envoyait en quarantaine, où elle restait jusqu’à ce que l’ordre de libération soit signé. Cela durait parfois plusieurs mois, mais au minimum quinze jours. Or, durant cette période, il y a eu une politique de libération des détenues de droit commun et des associales allemandes, pour les envoyer comme main-d’oeuvre dans les usines d’Allemagne. Il est donc impossible d’imaginer que, dans toute l’Allemagne, on pouvait ignorer qu’il y avait des camps de concentration, et ce qui s’y passait, puisque ces femmes sortaient de là, et qu’il est difficile de croire qu’elles n’ont jamais parlé. D’autre part, dans les usines où travaillaient des détenues, les Vorarbeiterinnen, c’est-àdire les contremaîtresses, étaient des civiles allemandes qui étaient en contact avec les détenues, et qui pouvaient leur parler. Les Aufseherinnen d’Auschwitz, qui sont venues après chez Siemens à Ravensbrück comme Aufseherinnen, étaient d’anciennes travailleuses libres de chez Siemens à Berlin, et elles se sont retrouvées avec les contremaîtresses qu’elles avaient connues à Berlin, et elles leur racontaient devant nous ce qu’elles avaient vu à Auschwitz. On ne peut donc pas croire que cela ne se savait pas en Allemagne.
Lorsque nous avons quitté Auschwitz nous n’en croyions pas nos yeux, et nous avions le coeur très serré en voyant ce petit groupe de 49 que nous étions devenues, par rapport au groupe de 230 qui était entré dix-huit mois plus tôt.
Mais nous avions l’impression de sortir de l’enfer, et pour la première fois, un espoir de revivre et de revoir le monde nous était donné.
M. Dubost : Où vous a-t-on envoyée, Madame ?
Mme V-C : En sortant d’Auschwitz nous avons été envoyées à Ravensbrück. Là, nous avons été conduites au bloc des N.N., qui voulait dire « Nacht und Nebel » c’est-à-dire « le secret ». dans ce bloc, avec nous, il y avait des Polonaises, portant le matricule 7.000, et quelques-unes qu’on appelait les « lapins », parce qu’elles avaient servi de cobayes. On choisissait dans leurs transports des jeunes filles ayant les jambes bien droites et étant elles-mêmes bien saines, et on leur faisait subir les opérations. A certaines, on a enlevé des parties d’os dans les jambes ; à d’autres, on a fait des injections, mais je ne saurais pas dire de quoi. Il y avait parmi les opérées une grande mortalité. Aussi les autres, quand on est venu les chercher pour les opérer, ont-elles refusé de se rendre au Revier. On les a conduites de force au cachot, et c’est là que le professeur venu de Berlin les opérait, en uniforme, sans prendre aucune précaution aseptique, sans mettre de blouse, sans se laver les mains. Il y a des survivantes de ces « lapins », elles souffrent encore énormément maintenant. Elles ont, par périodes, des suppurations et comme on ne sait pas quels traitements elles ont subis, il est très difficile de les guérir.
M. Dubost : Les internées étaient-elles tatouées à leur arrivée ?
Mme V-C : Non, à Ravensbrück, on n’était pas tatoué, mais par contre on passait un examen gynécologique, et comme on ne prenait aucune précaution et qu’on se servait des mêmes instruments, il y avait des contagions de maladies, étant donné que les détenues politiques étaient mélangées. Dans le bloc 32, où nous étions, il y avait également des prisonnières de guerre russes qui avaient refusé de travailler volontairement dans des usines de munitions. Elles avaient été conduites à cause de cela à Ravensbrück. Comme elles continuaient de refuser, on leur a fait subir toutes sortes de brimades, telles que de les laisser debout devant le bloc sans manger. Une partie a été envoyée en transport à Barth. Une autre a été employée pour porter les bidons dans le camp. Il y avait également, au Strafblock et au Bunker, des détenues ayant refusé de travailler pour les usines de guerre.
M. Dubost : Vous parlez là des prisons du camp ?
Mme V-C : Des prisons du camp. Du reste, la prison du camp, je l’ai visitée, c’était une prison civile, une vraie prison.
M. Dubost : Combien y a-t-il eu de Français dans ce camp ?
Mme V-C : De 8 000 à 10 000.
M. Dubost : Combien y a-t-il eu de femmes en tout ?
Mme V-C : Au moment de la libération, le chiffre matricule était 105 000 et quelques. Il y a eu également, dans le camp, des exécutions. On appelait les numéros à l’appel le matin, puis elles partaient à la Kommandantur et on ne les revoyait pas. Quelques jours après, les vêtements redescendaient à l’Effektenkammer, où l’on gardait les habits des détenues, et au bout d’un certain temps, leurs fiches disparaissaient des fichiers du camp.
M. Dubost : Le système de détention était le même à Auschwitz ?
Mme V-C : A Auschwitz, visiblement le but était l’extermination. On ne s’occupait pas du rendement. On était battu pour rien du tout. Il suffisait d’être debout du matin au soir, mais le fait que l’on porte une brique ou dix briques n’avait pas d’importance. On se rendait bien compte qu’on utilisait le matériel humain esclave, et pour le faire mourir, c’était cela le but ; alors qu’à Ravensbrück le rendement jouait un grand rôle.
C’était un camp de triage. Quand des transports arrivaient à Ravensbrück ils étaient expédiés très rapidement, soit dans des usines de munitions, soit dans des poudreries, soit pour faire des terrains d’aviation, et les derniers temps pour creuser des tranchées. Pour partir dans les usines, cela se pratiquait de la façon suivante : les industriels ou leurs contremaîtres, ou leurs responsables venaient eux-mêmes, accompagnés des SS, choisir et sélectionner. On avait l’impression d’un marché d’esclaves : ils tâtaient les muscles, regardaient la bonne mine, puis ils faisaient leur choix. Ensuite, on passait devant le médecin, déshabillée, et il décidait si on était apte ou non à partir au travail dans les usines. Les derniers temps, la visite au médecin n’était plus que pro forma, car on prenait n’importe qui. Le travail était exténuant, surtout à cause du manque de nourriture et de sommeil, puisqu’en plus des douze heures effectives de travail, il fallait faire l’appel le matin et le soir…
A Ravensbrück même, il y avait l’usine Siemens où l’on fabriquait du matériel téléphonique, et des instruments pour la radio des avions. Puis, il y avait à l’intérieur du camp des ateliers de camouflage d’uniformes et de différents ustensiles utilisés par les soldats ? Un de ceux que je connais le mieux…
Le Président : Je pense qu’il vaut mieux suspendre l’audience pendant dix minutes. (L’audience est suspendue)
M. Dubost : Avez-vous vu, Madame, des chefs SS et des membres de la Wehrmacht faire des visites dans les camps de Ravensbrück et d’Auschwitz, pendant que vous y étiez ?
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Savez-vous si des personnalités du Gouvernement allemand sont venues visiter ces camps ?
Mme V-C : Je ne le sais que pour Himmler. En-dehors de Himmler, je ne sais pas.
M. Dubost : Quels étaient les gardiens de ces camps ?
Mme V-C : Au début, c’étaient seulement des SS. A partir du printemps 1944, les jeunes SS, dans beaucoup de compagnies, ont été remplacés par des vieux de la Wehrmacht ; à Auschwitz et également à Ravensbrück, nous avons été gardées par des soldats de la Wehrmacht, à partir de 1944.
M. Dubost : Vous portez témoignage, par conséquent, que sur l’ordre du Grand Etat-Major (O.K.W) allemand, l’Armée allemande a été mêlée aux atrocités que vous nous avez décrites ?
Mme V-C : Evidemment, puisque nous étions gardées également par la Wehrmacht, cela ne pouvait pas être sans ordres.
M. Dubost : Votre témoignage est formel, et il atteint à la fois les SS et l’Armée ?
Mme V-C : Absolument.
M. Dubost : Voudriez-vous parler de l’arrivée à Ravensbrück, pendant l’hiver 1944, des Juives hongroises qui avaient été arrêtées en masse. Vous étiez à Ravensbrück, c’est un fait dont vous pouvez témoigner ?
Mme V-C : Oui, naturellement, j’y ai assisté. Il n’y avait plus de place dans les blocs ; les détenues couchaient déjà à quatre par lit. Alors il a été dressé au milieu du camp une grande tente. Dans cette tente, on avait mis de la paille, et les détenues hongroises ont été conduites sous cette tente. Elles étaient dans un état effroyable. Il y avait énormément de pieds gelés, parce qu’elles avient été évacuées de Budapest, et elles avaient fait une grande partie du trajet à pied dans la neige. Un grandnombre étaient mortes. Celles qui sont arrivées à Auschwitz ont donc été conduites sous cette tente, et là, il en mourait énormément. Tous les jours, une équipevenait rechercher les cadavres sous la tente. Un jour, en revenant à mon bloc, qui était voisin, pendant le nettoyage…
Le Président : Parlez-vous de Ravensbrück ou d’Auschwitz ?
Mme V-C : Je parle de Ravensbrück maintenant. C’était en hiver 1944, je crois, à peu près en novembre ou décembre. Je ne peux pas préciser le mois, parce que, dans les camps de concentration, c’est très difficile de donner une date précise, étant donné qu’à un jour de torture succédait un jour de torture égal ;la monotonie rend très difficile les points de repère. Je dis donc qu’un jour, en passant devant la tente, au moment où on la nettoyait, j’ai vu un tas de fumier qui fumait, et tout d’un coup, j’ai réalisé que c’était du fumier humain, car les malheureuses n’avaient plus la force de se traîner jusqu’aux lieux d’aisance. Elles pourrissaient donc dans cette saleté.
M. Dubost : Dans quelles conditions travaillait-on à l’atelier où l’on fabriquait des vestes
Mme V-C : A l’atelier des uniformes…
M. Dubost : C’était l’atelier du camp ?
Mme V-C : C’était l’atelier du camp qu’on appelait la « Schneiderei I ». On fabriquait 200 vestes ou pantalons par jour. Il y avait deux équipes, une de jour et une de nuit, douze heures de travail par équipe. L’équipe de nuit, au début à minuit, lorsque la norme était atteinte, mais dans ce cas seulement, touchait une mince tartine de pain. Par la suite cela a été supprimé. Le travail était à une cadence effrénée, les détenues ne pouvaient même pas se rendre au lavabo. Pendant la nuit et le jour, elles étaient effroyablement battues, tant par les SS femmes que par les hommes, parce qu’un aiguille cassait, parce que le fil était de mauvaise qualité, parce que la machine s’arrêtait, ou tout simplement parce quelles avient une tête qui ne plaisait pas à ces messieurs ou ces dames. Vers la fin de la nuit, on voyait qu’elles étaient si épuisées que chaque effort leur coûtait. leur front perlait de sueur. elles ne voyaient presque plus clair. quand la norme n’était pas atteinte, le chef de l’atelier Binder se précipitait et battait à tour de bras l’une après l’autre, toute la rangée des femmes de la chaîne, ce qui fait que les dernières attendaient, pétrifiées de terreur, que leur tour arrive.
Quand on voulait aller au Revier, il fallait avoir l’autorisation des SS, qui la donnaient très rarement, et même dans ce cas, si le médecin donnait une dispense de travail de quelques jours, il arrivait couramment que les SS viennent rechercher la malade dans son lit pour la remettre à sa machine. L’atmosphère était effroyable, parce qu’à cause de « l’occultation », la nuit, on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres. Alors, 600 femmes travaillaient pendant 12 heures sans aucune ventilation. Toutes celles qui travaillaient à la Schneiderei devenaient squelettiques au bout de quelques mois, elles commençaient à tousser, leur vue baissait, elles avaient des tics nerveux, causés par la peur des coups.
Je connais bien les conditions de cet atelier, car ma petite amie Marie Rubiano, une petite Française qui, venant de passer trois ans à la prison de Kottbus, en arrivant à Ravensbrück avait été envoyée à la Schneiderei, et chaque soir, elle me racontait son martyre. Un jour, épuisée, elle a obtenu d’aller au revier et comme ce jour-là, la « Schwester » allemande, Erica, était de moins mauvaise humeur que de coutume, on l’a passée à la radio. Les deux poumons étaient atteints très gravement, elle a été envoyée à l’horrible bloc 10, le bloc des tuberculeuses. ce bloc était particulièrement effroyable, parce que les tuberculeuses n’étant pas considérées comme main d’oeuvre récupérable, on ne les soignait pas, et il n’y avait même pas de personnel assez nombreux pour les laver. Il n’y avait pour ainsi dire pas de médicaments. La petite Marie a été mise dans la chambre des bacillaires, c’est-à-dire celles qu’on considérait comme perdues. Elle y a passé quelques semaines, et elle n’avait même plus le courage de lutter pour vivre. Il faut dire que l’atmosphère de cette salle est particulièrement déprimante. Elles étaient très nombreuses, plusieurs par lit, dans des lits de trois étages, dans une atmosphère surchauffée, couchées entre détenues de différentes nationalités, ce qui faisait qu’elles ne pouvaient même pas se parler entre elles. Aussi, le silence de cette antichambre de la mort n’était-il coupé que par les glapissements des associales allemandes qui faisaient le service, et de temps en temps par le sanglot etouffé d’une petite fille qui pensait à sa mère, à son pays qu’elle ne reverrait jamais. Pourtant, Marie Rubiano ne mourant pas assez vite au gré des SS, un jour, le Dr Winkelmann, le spécialiste des sélections à Ravensbrück, l’a inscrite sur la liste noire, et le 9 février 1945, avec 72 autres tuberculeuses, dont 6 Françaises, elle a été hissée dans le camion pour la chambre à gaz.
Durant cette période, dans tous les Revier, on envoyait aux gaz toutes les malades qu’on pensait ne plus pouvoir utiliser pour le travail. La chambre à gaz à Ravensbrück était juste derrière le mur du camp, à côté du four crématoire. Quand les camions venaient chercher les malades, nous entendions le bruit du moteur à travers le camp et il s’arrêtait juste à côté du four crématoire dont la cheminée dépassait les hauts murs du camp. A la libération, je me suis rendue dans ces lieux et j’ai visité la chambre à gaz qui était une baraque en planches hermétiquement fermée et, à l’intérieur, il y avait encore l’odeur désagréable des gaz. Je sais qu’à Auschwitz, les gaz étaient les mêmes que ceux employés contre les poux et ils laissaient comme trace de petits cristaux vert pâle, qu’après avoir ouvert les fenêtres du bloc, on balayait. Je sais ces détails parce que les hommes utilisés à la désinfection des blocs contre les poux étaient en contact avec ceux qui gazaient les êtres humains, et ils leur ont dit que c’étaient les mêmes gaz qui étaient employés.
M. Dubost : Etait-ce le seul moyen utilisé pour exterminer les internés, à Ravensbrück ?
Mme V-C : Au bloc 10, on avait expérimenté également une poudre blanche un jour, la Schwester allemande Martha est arrivée dans le bloc et a distribué, à une vingtaine de malades, une poudre. A la suite de cela, les malades se sont endormies profondément : quatre ou cinq ont été prises de vomissements, c’est ce qui leur a sauvé la vie ; dans le courant de la nuit, peu à peu les ronflements se sont arrêtés et les malades étaient mortes. Je sais cela parce que j’allais chaque jour visiter des Françaises dans ce bloc ; deux des infirmières étaient françaises et la doctoresse Louise Le Porz, de Bordeaux, qui est rentrée, pourrait également en témoigner.
M. Dubost : Etait-ce fréquent ?
Mme V-C : Durant mon séjour, cet exemple a été le seul à l’intérieur du revier, mais on employait également ce système au Jugendlager, ainsi appelé parce que c’était un ancien pénitencier de jeunes délinquantes allemandes. Vers le début de l’année 1945, le Dr Winkelmann, ne se contentant plus de faire des sélections dans le Revier, en faisait également dans les blocs ; toutes les détenues devaient faire l’appel, les pieds nus, et montrer leur poitrine et leurs jambes. Toutes celles qui étaient trop agées, malades, trop maigres, ou qui avaient les jambes gonflées d’oedème, étaient mises de côté, puis envoyées dans ce Jugendlager à un quart d’heure du camp de Ravensbrück.
Je l’ai visité à la libération : on avait fait passer dans les blocs un ordre, disant que les vieilles femmes et les malades qui ne pouvaient pas travailler devaient se faire inscrire pour le Jugendlager, où elles seraient beaucoup mieux, où elles ne travailleraient pas, et où il n’y aurait pas d’appel. ; nous l’avons su, par la suite par des employés qui travaillaient au Jugendlager, dont la chef de camp, une Autrichienne que je connaissais depuis Auschwitz, nommée Betty Wentz, et par les quelques survivantes, dont Irène Ottelard, une Française habitant Drancy, 17, rue de la Liberté, qui a été rapatriée en même temps que moi et que j’avais soignée après la libération ; par elles, nous avons eu des détails sur le Jugendlager.
M. Dubost : Pouvez-vous me dire, Madame, si vous pouvez répondre à cette question : les médecins SS qui procédaient aux sélections agissaientils de leur propre mouvement ou conformément à des ordres reçus
Mme V-C : Ils agissaient conformément à des ordres reçus, puisque l’un d’eux, le Dr Lukas, ayant refusé de participer aux sélections, a été retiré du camp et on a envoyé de Berlin le Dr Winkelmann à sa place.
M. Dubost : Etes-vous témoin personnel de ces faits ?
Mme V-C : C’est lui qui l’a dit en s’en allant, à la chef du bloc 10 et à la doctoresse Louise Le Porz.
M. Dubost : Pourriez-vous nous donner quelques renseignements sur les conditions dans lesquelles vivaient les hommes du camp voisin à Ravensbrück, au lendemain de la libération, lorsque vous avez pu les voir ?
Mme V-C : Je crois qu’il vaut mieux parler d’abord du Jugendlager, puisque chronologiquement, cela se passe avant.
M. Dubost : Si vous voulez, bien.
Mme V-C : Au Jugendlager, les vieilles femmes et les malades qui étaient parties de notre camp ont été mises dans des blocs où il n’y avait pas d’eau et pas de commodités, sur des paillasses par terre, si serrées qu’on ne pouvait pas passer entre elles, ce qui faisait que la nuit, on ne pouvait pas dormir à cause du va-et-vient, et que les détenues se souillaient les unes les autres en passant. Les paillasses étaient pourries et pullulaient de poux, les détenues qui pouvaient se tenir debout faisaient l’appel pendant plusieurs heures jusqu’à ce qu’elles s’écroulent. Au mois de février, on leur a retiré leurs manteaux, mais elles continuaient à faire l’appel dehors, ce qui a beaucoup augmenté la mortalité. Elles ne recevaient comme nourriture qu’une mince tranche de pain et un demi-quart de soupe au rutabaga, et comme boisson, pour 24 heures, un demiquart de tisane. Elles n’avaient pas d’eau pour boire, pour se laver ou pour laver leurs gamelles. Il y avait également au Jugendlager un Revier où l’on mettait toutes celles qui ne pouvaient pas se tenir debout. Pendant les appels, périodiquement, l’Aufseherin choisissait des détenues que l’on déshabillait en ne leur laissant que leur chemise ; on leur rendait leur manteau pour monter en camion et elles partaient pour les gaz ; quelques jours après, les manteaux revenaient à la Kammer, c’est-à-dire à l’entrepôt de vêtements, et les fiches étaient marquées « Mittwerda ».
Les détenues qui travaillaient aux fichiers nous ont dit que le mot « Mittwerda » n’existait pas et que c’était une nomenclature pour les gaz. Au Revier, on distribuait périodiquement de la poudre blanche et les malades mouraient comme celles du bloc 10 dont j’ai parlé tout à l’heure. On faisait…
Le Président : Les conditions du camp de Ravensbrück semblent être les mêmes que celles d’Auschwitz ; serait-il possible, après avoir entendu ces détails, de s’occuper de la question de façon plus générale, à moins qu’il n’y ait une différence substantielle entre Ravensbrück et Auschwitz ?
M. Dubost : Je crois qu’il y a une différence qui nous a été exposée par le témoin et qui est la suivante : c’est qu’à Auschwitz, les internées étaient exterminées purement et simplement, il ne s’agissait que d’un camp d’extermination, tandis qu’à Ravensbrück, elles étaient internées pour travailler, elles étaient exténuées de travail jusqu’à ce qu’elles en meurent.
Le Président : S’il y a d’autres différences entre les deux camps, sans doute demanderez-vous au témoin ces différences
M. Dubost : Je n’y manquerai pas.
Le Président : Pouvez-vous indiquer au Tribunal dans quel état se trouvait le camp des hommes au moment de la libération et combien il restait de survivants ?
Mme V-C : Lorsque les Allemands sont partis, ils ont laissé 2 000 femmes malades et un certain nombre de volontaires dont moi-même, pour les soigner ; ils nous ont laissées sans eau et sans lumière ; heureusement les Russes sont arrivés le lendemain. Nous avons donc pu aller jusqu’au camp des hommes et là, nous avons trouvé un spectacle indescriptible ; ils étaient depuis cinq jours sans eau ; il y avait 800 malades graves, trois médecins et sept infirmières qui n’arrivaient pas à retirer les morts de parmi les malades. Nous avons pu, grâce à l’Armée Rouge, transporter ces malades dans des blocs propres et leur donner des soins et de la nourriture, mais malheureusement, je ne peux donner le chiffre que pour les Français : il y en avait 400 quand nous avons trouvé le camp, et il n’y en a que 150 qui ont pu regagner la France ; pour les autres, il était trop tard, malgré les soins…
Le Président : Avez-vous assisté à des exécutions et dans quelles conditions étaient-elles faites au camp ?
Mme V-C : Je n’ai pas assisté aux exécutions, je sais seulement que la dernière qui a eu lieu, c’est le 22 avril, huit jours avant l’arrivée de l’Armée Rouge ; on envoyait les détenues, comme je l’ai dit, à la Kommandantur puis leurs vêtements revenaient et on retirait leur carte du fichier.
Le Président : La situation de ce camp était-elle exceptionnelle ? Ou pensezvous qu’il s’agisse d’un système ?
Mme V-C : Il est difficile de donner une idée juste des camps de concentration quand on n’y a pas été soi-même, parce qu’on ne peut pas donner l’impression de cette longue monotonie, et quand on demande ce qui était le pire, il est impossible de répondre, parce que tout était atroce. C’est atroce de mourir de faim, de mourir de soif, d’être malade, de voir mourir autour de soi ses compagnes, sans rien pouvoir faire, de penser à ses enfants, à son pays qu’on ne reverra pas, et par moments nous nous demandions nous-mêmes si ce n’était pas un cauchemar tellement cette vie nous semblait irréelle dans son horreur. Nous n’avions qu’une volonté pendant des mois et des années, c’était de sortir à quelques-unes vivantes pour pouvoir dire au monde ce que c’est que les bagnes nazis : partout, à Auschwitz comme à Ravensbrück – et mes compagnes qui ont été dans d’autres camps rapportent la même chose – cette volonté systématique et implacable d’utiliser les hommes comme des esclaves, et quand ils ne peuvent plus travailler, de les tuer.
Le Président : Vous n’avez plus rien à déclarer ?
Mme V-C : Non.
Le Président : Je vous remercie. Si le Tribunal veut interroger le témoin, j’en ai achevé.
Général Rudenko : Je n’ai pas de question à poser.
Dr Hans Marx (Avocat, remplaçant M. Babel, avocat des SS, absent) : Le Dr Babel n’a pu venir ce matin, car il a dû se rendre à une conférence de M. le GénéralMitchell. Messieurs les Juges, je voudrais me permettre de poser au témoin quelques questions pour l’éclaircissement du sujet : Madame Couturier, vous disiez que vous aviez été arrêtée par le Police française ?
Mme V-C : Oui.
Dr Marx : Pour quel motif avez-vous été arrêtée ?
Mme V-C : Résistance. J’appartenais à un mouvement de résistance.
Dr Marx : Une autre question… Quelle était la position que vous occupiez ?
Mme V-C : Quelle position ?
Dr Marx : La position que vous occupiez ? A ce moment, aviez-vous une position quelconque ?
Mme V-C : Où ?
Dr Marx : Par exemple, étiez-vous institutrice ?
Mme V-C : Avant la guerre ? Je ne vois pas très bien ce que la question a à voir avec le sujet ? J’étais journaliste.
Dr Marx : Oui, c’est ce que je voulais dire. Dans vos déclarations, vous avez fait remarquer que vous aviez une grande habitude du style et de la parole, et c’est pourquoi je vous demandais si vous aviez occupé une position dans cette branche, si vous étiez institutrice ou si vous faisiez des conférences, par exemple ?
Mme V-C : Non, j’étais reporterphotographe.
Dr Marx : Comment pouvez-vous expliquer que vous-même ayez pu passer au travers de tout cela, et que vous soyez revenue dans un bon état de santé ?
Mme V-C : D’abord, j’ai été libérée il y a un an ; en un an de temps, on a le temps de se remettre ; ensuite, j’ai été dix mois, comme je l’ai indiqué, en quarantaine, et j’ai eu la chance de ne pas mourir du typhus exanthématique, bien que je l’aie eu et que j’aie été malade pendant trois mois et demi. D’autre part, à Ravensbrück, les derniers temps, comme je sais l’allemand, j’ai travaillé pour faire l’appel du revier et je n’avais donc pas à subir les intempéries ; mais par contre, sur 230, nous rentrons à 49 de mon transport, et nous n’étions plus que 52 au bout de 4 mois ; j’ai eu la chance de revenir.
Dr Marx : Est-ce que vos déclarations émanent de votre propre observation, ou bien s’agit-il de communications qui vous auraient été faites par d’autres personnes ?
Mme V-C : Chaque fois que c’est le cas, je l’ai signalé dans ma déclaration je n’ai jamais cité quoi que ce soit qui n’ait été vérifié aux sources et par plusieurs personnes, mais la majorité de ma déclaration porte sur un témoignage personnel.
Dr Marx : Comment pouvez-vous expliquer que vous ayez ainsi des connaissances statistiques tellement exactes ? Par exemple vous parlez de 700 000 Juifs qui seraient arrivés de Hongrie.
Mme V-C : Je vous ai dit que j’avais travaillé dans les bureaux, et en ce qui concerne Auschwitz, que j’étais amie de la secrétaire de la Oberaufseherin dont j’ai indiqué le nom et l’adresse au Tribunal.
Dr Marx : On prétend cependant qu’il y aurait 350 000 Juifs seulement venus de Hongrie, ceci d’après les indications du chef de service de la Gestapo, Eichmann.
Mme V-C : Je ne veux pas discuter avec la Gestapo. J’ai de bonnes raisons pour savoir que ce qu’elle déclare n’est pas toujours exact.
Dr Marx : Bien. Comment avez-vous été traitée vous-même ? Avez-vous été bien traitée ?
Mme V-C : Comme les autres.
Dr Marx : Comme les autres ? Vous avez dit aussi que le peuple allemand était au courant de ce qui se passait à Auschwitz ; sur quoi se base cette assertion ?
Mme V-C : Je l’ai dit, d’une part, sur le fait que lorsque nous sommes parties, les soldats lorrains de la Wehrmacht nous ont dit dans le train : « Si vous saviez où vous allez, vous ne seriez pas si pressées d’y arriver ».
D’autre part, sur le fait que les Allemandes qui sortaient de la quarantaine pour aller travailler dans des usines étaient au courant de ces faits et qu’elles disaient toutes qu’elles le raconteraient dehors.
Troisièmement sur le fait que, dans toutes les usines où travaillaient des « Haeftlinge », des détenues, elles étaient en contact avec des civils allemands, ainsi que les Aufseherinnen qui avaient des relations avec leurs familles et leurs amis et qui souvent se vantaient de ce qu’elles avaient vu.
Dr Marx : Encore une question : jusqu’en 1942, vous avez pu constater la conduite des soldats allemands à Paris. Est-ce que les soldats allemands ne se sont pas conduits d’une façon convenable, est-ce qu’ils ne payaient pas ce qu’ils réquisitionnaient.
Mme V-C : Je n’en ai pas la moindre idée ; je ne sais s’ils payaient ce qu’ils réquisitionnaient. Quant aux traitements convenables, trop des miens ont été fusillés ou massacrés pour que je puisse partager votre opinion sur cette question.
Dr Marx : Je n’ai pas d’autre question à poser au témoin.
Le Président : Si vous n’avez plus d’autre question à poser, il n’y a plus rien à dire. Il y a trop de rires dans cette salle, je l’ai déjà dit. (Au Docteur Marx) J’ai cru que vous aviez dit que vous n’aviez plus de question à poser.
Dr Marx : Je voulais simplement me permettre, au nom de l’avocat Babel, de faire la réserve qu’il voudra certainement interroger le témoin en contre-interrogatoire.
Le Président : Le Docteur Babel, dites-vous ?
Dr Marx : Oui.
Le Président : Je m’excuse, certainement, mais le Docteur Babel sera-t-il revenu ?
Dr Marx : – Je suppose qu’il sera là cet après-midi ; il est dans le Palais, mais il lui faut le temps de lire le compte-rendu.
Le Président : Nous allons considérer le fait, si le Docteur Babel est là cet après-midi, que le Docteur Babel fasse une autre demande. D’autres avocats de la Défense allemande veulentils poser des questions au témoin ? Monsieur Dubost, avez-vous d’autres questions que vous désiriez demander dans un nouvel interrogatoire ?
M. Dubost : Je n’ai plus de questions à poser, Monsieur le Président.
Le Président : Le témoin peut se retirer.
Mme Claude Vaillant-Couturier se retire..
Lundi 28 janvier 1946
Quarante-quatrième journée - Audience du matin
M. Dubost : Avec l’autorisation du Tribunal, nous poursuivrons cette partie de l’exposé du cas français par l’audition d’un témoin qui a vécu pendant plus de trois ans dans les camps de concentration allemands.
(On introduit Madame Claude Vaillant-Couturier.)
Le Président : Quel est votre nom ? Voulez-vous vous lever, je vous prie ? Voulez-vous prêter serment en français ?
Madame Vaillant-Couturier (Mme V-C) : Claude Vaillant-Couturier.
Le Président : Répétez le serment avec moi : « Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. » Levez la main droite et dites : « Je le jure ».
Mme V-C : – Je le jure
Le Président : Asseyez-vous et parlez lentement. Vous vous appelez ?
Mme V-C : Vaillant-Couturier, Marie, née Claude Vogel.
M. Dubost : Votre nom actuel est Madame Vaillant-Couturier ?
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Vous êtes la veuve de M. Vaillant-Couturier.
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Vous êtes née à Paris le 3 novembre 1912 ?
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Vous êtes de nationalité française ?
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Née de nationalité française ?
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Parents eux-mêmes de nationalité française ?
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Vous êtes Député à l’Assemblée Constituante ?
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Vous êtes Chevalier de la Légion d’Honneur ?
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Et vous venez d’être décorée par le général Legentilhomme aux Invalides ?
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Vous avez été arrêtée et déportée. Pouvez-vous faire votre témoignage ?
Mme V-C : J’ai été arrêtée le 9 février 1942 par la Police française de Pétain, qui m’a remise aux autorités allemandes au bout de six semaines.
Je suis arrivée le 20 mars à la prison de la Santé, au quartier allemand.
J’ai été interrogée le 9 juin 1942. A la fin de mon interrogatoire, on a voulu me faire signer une déclaration qui n’était pas conforme à ce que j’avais dit. Comme j’ai refusé de la signer, l’officier qui m’interrogeait m’a menacée, et comme je lui ai dit que je ne craignais pas la mort ni d’être fusillée, il m’a dit : « Mais nous avons à notre disposition des moyens bien pires que de fusiller les gens pour les faire mourir », et l’interprète m’a dit : « Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Vous allez partir dans un camp de concentration allemand ; on n’en revient jamais. »
M. Dubost : Vous avez été conduite alors en prison ?
Mme V-C : J’ai été reconduite à la prison de la Santé, où j’ai été mise au secret.
J’ai cependant pu communiquer avec mes voisins par les canalisations et par les fenêtres. je me trouvais dans la cellule à côté de celles du philosophe Georges Politzer et du physicien Jacques Salomon, le gendre du professeur Langevin, l’élève de Curie, l’un des premiers qui ait étudié la désintégration atomique.
Georges Politzer m’a raconté par la canalisation que, pendant son interrogatoire, après l’avoir martyrisé, on lui a demandé s’il ne voulait pas écrire des brochures théoriques pour le national-socialisme. Comme il a refusé, on lui a dit qu’il ferait partie du premier train d’otages qui seraient fusillés.
Quant à Jacques Salomon, il a été également horriblement torturé, puis jeté au cachot, d’où il n’est sorti que le jour de son exécution pour dire au revoir à sa femme, également arrêtée, et à la Santé.
Hélène SalomonLangevin m’a raconté à Romainville, où je l’ai retrouvée en quittant la Santé, que lorsqu’elle s’était approchée de son mari pour l’embrasser, il avait poussé un gémissement et lui avait dit : « Je ne peux pas te prendre dans mes bras car je ne peux plus bouger »
Chaque fois que les détenus revenaient de l’interrogatoire, on entendait s’échapper par les fenêtres des gémissements et les détenus disaient qu’ils ne pouvaient plus se remuer. Durant le séjour de cinq mois que j’ai fait à la Santé, plusieurs fois on est venu chercher des otages pour les fusiller.
En quittant la Santé le 20 août 1942, j’ai été conduite au fort de Romainville, qui servait de camp d’otages. Là, j’ai assisté deux fois à des prises d’otages, le 21 août et le 22 septembre. Parmi les otages emmenés, il y avait les maris des femmes qui se trouvaient avec moi et qui sont parties pour Auschwitz ; la plupart y sont mortes. Ces femmes, pour la plupart, n’étaient arrêtées qu’à cause de l’activité de leur mari ; elles n’en avaient aucunes elles-mêmes.
M. Dubost : Vous êtes partie à Auschwitz à quel moment ?
Mme V-C : Je suis partie pour Auschwitz le 23 janvier et arrivée le 27.
M. Dubost : Vous faisiez partie d’un convoi ?
Mme V-C : Je faisais partie d’un convoi de 230 françaises. Il y avait parmi nous Danielle Casanova qui est morte à Auschwitz, Maï Politzer, qui est morte à Auschwitz, Hélène Salomon. Il y avait de vieilles femmes…
M. Dubost : Quelle était leur condition sociale ?
Mme V-C : Des intellectuelles, des institutrices, un peu de toutes les conditions sociales. Maï Politzer était médecin ; elle était la femme du philosophe Georges Politzer. Hélène Salomon est la femme du physicien Salomon ; c’est la fille du professeur Langevin. Danielle Casanova était chirurgien-dentiste et elle avait une grande activité parmi les femmes ; c’est elle qui a monté un mouvement de résistance parmi les femmes de prisonniers.
M. Dubost : Combien êtes-vous revenues sur 230 ?
Mme V-C : 49. Il y avait dans le transport, de vieilles femmes ; entre autres, je me souviens d’une de 67 ans, arrêtée pour avoir eu dans sa cuisine le fusil de chasse de son mari, qu’elle gardait en souvenir et qu’elle n’avait pas déclaré pour qu’on ne le lui prenne pas. Elle est morte au bout de 15 jours à Auschwitz.
Le Président : Vous avez dit que seulement 49 étaient revenues. Voulez-vous dire que seulement 49 sont arrivées à Auschwitz ?
Mme V-C : Non, seulement 49 sont revenues en France. Il y avait également des infirmes, en particulier une chanteuse qui n’avait qu’une qu’une jambe. Elle a été sélectionnée et gazée à Auschwitz.
Il y avait aussi une jeune fille de 16 ans, une élève de lycée, Claudine Guérin. Elle est morte également à Auschwitz.
Il y avait aussi deux femmes qui avaient été acquittées par le Tribunal militaire allemand ; elles s’appellent Marie Alonzo et Marie-Thérèse Fleuri ; elles sont mortes à Auschwitz.
Le voyage était extrêmement pénible, car nous étions 60 par wagon et l’on ne nous a pas distribué de nourriture ni de boissons pendant le trajet. Comme nous demandions aux arrêts aux soldats lorrains enrôlés dans la Wehrmacht qui nous gardaient si l’on arrivait bientôt, ils nous ont répondu : « Si vous saviez où vous allez, vous ne seriez pas pressées d’arriver ».
Nous sommes arrivées à Auschwitz au petit jour.
On a déplombé nos wagons et on nous a fait sortir à coups de crosses pour nous conduire au camp de Birkenau, qui est une dépendance du camp d’Auschwitz, dans une immense plaine qui, au mois de janvier, était glacée.
Nous avons fait le trajet en tirant nos bagages.
Nous sentions tellement qu’il y avait peu de chance d’en ressortir – car nous avions déjà rencontré les colonnes squelettiques qui se dirigeaient au travail – qu’en passant le porche, nous avons chanté la Marseillaise pour nous donner du courage.
On nous a conduites dans une grande barraque, puis à la désinfection.
Là, on nous a rasé la tête et on nous a tatoué sur l’avant-bras gauche le numéro de matricule.
Ensuite, on nous a mises dans une grande pièce pour prendre un bain de vapeur et une douche glacée.
Tout celà se passait en présence des SS, hommes et femmes, bien que nous soyons nues.
Après, on nous a remis des vêtements souillés et déchirés, une robe de coton et une jaquette pareille.
Comme ces opérations avaient pris plusieurs heures, nous voyions, des fenêtres du bloc où nous nous trouvions, le camp des hommes, et vers le soir, un orchestre s’est installé. Comme il neigeait, nous nous demandions pourquoi on faisait de la musique. A ce moment-là, les commandos de travail d’hommes sont rentrés. Derrière chaque commando, il y avait des hommes qui portaient des morts. Comme ils pouvaient à peine se traîner eux-mêmes, ils étaient relevés à coups de crosses ou à coups de bottes, chaque fois qu’ils s’affaissaient.
Après celà, nous avons été conduites dans le bloc où nous devions habiter. Il n’y avait pas de lits, mais des bat-flanc de 2 mètres sur 2 mètres, où nous étions couchées à 9, sans paillasse et sans couverture la première nuit. Nous sommes demeurées dans des blocs de ce genre pendant plusieurs mois.
Pendant toute la nuit, on ne pouvait pas dormir, parce que chaque fois que l’une des 9 se dérangeait – et comme elles étaient toutes malades, c’était sans arrêt – elle dérangeait toute la rangée.
A trois heures et demie du matin, les hurlements des surveillantes nous réveillaient, et, à coups de gourdins, on était chassé de son grabat pour partir à l’appel.
Rien au monde ne pouvait dispenser de l’appel, même les mourantes devaient y être traînées.
Là, nous restions en rangs par cinq jusqu’à ce que le jour se lève, c’est-à-dire 7 à 8 heures du matin en hiver, et, lorsqu’il y avait du brouillard, quelquefois jusqu’à midi. Puis, les commandos s’ébranlaient pour partir au travail.
M. Dubost : Je vous demande pardon, pouvez-vous décrire les scènes de l’appel ?
Mme V-C : Pour l’appel, on était mis en rangs, par cinq, puis nous attendions jusqu’au jour que les Aufseherinnen, c’est-à-dire les surveillantes allemandes en uniforme, viennent nous compter. Elles avaient des gourdins et elles distribuaient, au petit bonheur la chance, comme ça tombait, des coups. Nous avons une compagne, Germaine Renaud, institutrice à Azay-le-Rideau, qui a eu le crâne fendu devant mes yeux par un coup de gourdin, durant l’appel.
Le travail à Auschwitz consistait en déblaiements de maisons démolies, constructions de routes et surtout assainissement des marais. C’était de beaucoup le travail le plus dur, puisqu’on était toute la journée les pieds dans l’eau et qu’il y avait danger d’enlisement. Il arrivait constamment qu’on soit obligé de retirer une camarade qui s’était enfoncée parfois jusqu’à la ceinture. Durant tout le travail, les SS hommes et femmes qui nous surveillaient nous battaient à coups de gourdins et lançaient sur nous leurs chiens. Nombreuses sont les camarades qui ont eu les jambes déchirées par les chiens. Il m’est même arrivée de voir une femme déchirée et mourir sous mes yeux, alors que le SS Tauber excitait son chien contre elle et ricanait à ce spectacle.
Les causes de la mortalité étaient extrêmement nombreuses. Il y avait d’abord le manque d’hygiène total. Lorsque nous sommes arrivées à Auschwitz, pour 12 000 détenues, il y avait un seul robinet d’eau non potable, qui coulait par intermittence. Comme ce robinet était dans les lavabos allemands, on ne pouvait y accéder qu’en passant par une garde de détenues allemandes de droit commun, qui nous battaient effroyablement. Il était donc presque impossible de se laver ou de laver son linge. Nous sommes restées pendant plus de trois mois sans jamais changer de linge ; quand il y avait de la neige, nous en faisions fondre pour pouvoir nous laver. plus tard, au printemps, quand nous allions au travail, dans la même flaque d’eau sur le bord de la route, nous buvions, nous lavions notre chemise ou notre culotte. Nous nous lavions à tour de rôle dans cette eau polluée. Les compagnes mouraient de soif, car on ne distribuait que deux fois par jour un demi-quart de tisane.
M. Dubost : Voulez-vous préciser en quoi consistait l’un des appels du début du mois de février ?
Mme V-C : Il y a eu le 5 février ce que l’on appelait un appel général.
M. Dubost : Le 5 février de quelle année ?
Mme V-C : 1 943. A 3 heures et demie, tout le camp…
M. Dubost : Le matin ?
Mme V-C : Le matin. A 3 heures et demie tout le camp a été réveillé et envoyé dans la plaine, alors que d’habitude l’appel se faisait à 3 heures et demie, mais à l’intérieur du camp.
Nous sommes restées, dans cette plaine, devant le camp, jusqu’à 5 heures du soir, sous la neige, sans recevoir de nourriture, puis, lorsque le signal a été donné, nous devions passer la porte une à une, et l’on donnait un coup de gourdin dans le dos, à chaque détenue, en passant, pour la faire courir.
Celle qui ne pouvait pas courir, parce qu’elle était trop vieille ou trop malade, était happée par un crochet et conduite au bloc 25, le bloc d’attente pour les gaz.
Ce jour-là, dix Françaises dans notre transport ont été happées ainsi et conduites au bloc 25.
Lorsque toutes les détenues furent rentrées dans le camp, une colonne, dont je faisais partie, a été formée pour aller relever dans la plaine les mortes qui jonchaient le sol comme sur un champ de bataille. Nous avons transporté dans la cour du bloc 25 les mortes et les mourantes, sans faire de distinction ; elles sont restées entassées ainsi. Ce bloc 25, qui était l’antichambre de la chambre à gaz – si l’on peut dire – je le connais bien, car, à cette époque, nous avions été transférées au bloc 26 et nos fenêtres donnaient sur la cour du 25. On voyait les tas de cadavres, empilés dans la cour, et, de temps en temps, une main ou une tête bougeait parmi ces cadavres, essayant de se dégager : c’était une mourante qui essayait de sortir de là pour vivre. La mortalité de ce bloc était encore plus effroyable qu’ailleurs, car, comme c’étaient des condamnées à mort, on ne leur donnait à manger et à boire que s’il restait des bidons à la cuisine, c’est-à-dire que souvent elles restaient plusieurs jours sans une goutte d’eau.
Un jour, une de nos camarades, Annette Epaux, une belle jeune femme de trente ans, passant devant le bloc, eut pitié de ces femmes qui criaient du matin au soir, dans toutes les langues : « A boire, à boire, de l’eau ». Elle est rentrée dans notre bloc chercher un peu de tisane mais, au moment où elle passait par le grillage de la fenêtre, la Aufseherin l’a vue, l’a prise par le collet et l’a jetée au bloc 25. Toute ma vie, je me souviendrai d’Annette Epaux. deux jours après, montée sur le camion qui se dirigeait vers la chambre à gaz, elle tenait contre elle une autre Française, la vieille Line Porcher, et au moment où le camion s’est ébranlé, elle nous a crié : « Pensez à mon petit garçon, si vous rentrez en France ». Puis elles se sont mises à chanter la Marseillaise. Dans le bloc 25, dans la cour, on voyait les rats, gros comme des chats, courir et ronger les cadavres et même s’attaquer aux mourantes, qui n’avaient plus la force de s’en débarrasser.
Une autre cause de mortalité et d’épidémie était le fait qu’on nous donnait à manger dans de grandes gamelles rouges qui étaient seulement passées à l’eau froide après chaque repas. Comme toutes les femmes étaient malades, et qu’elles n’avaient pas la force durant la nuit de se rendre à la tranchée qui servait de lieux d’aisance et dont l’abord était indescriptible, elles utilisaient ces gamelles pour un usage auquel elles n’étaient pas destinées. Le lendemain, on ramassait ces gamelles, on les portait sur un tas d’ordures et, dans la journée, une autre équipe venait les récupérer, les passait à l’eau froide, et les remettait en circulation.
Une autre cause de mort était la question des chaussures. dans cette neige et cette boue de Pologne, les chaussures de cuir étaient complètement abîmées au bout de huit à quinze jours. On avait donc les pieds gelés et des plaies aux pieds. Il fallait coucher sur ses souliers boueux de peur qu’on ne les vole, et presque chaque nuit, au moment de se lever pour l’appel, on entendait des cris d’angoisse : » On m’a volé mes chaussures « Il fallait alors attendre que tous les blocs soient vidés pour chercher sous les cadres les laissés-pourcompte. C’étaient parfois deux souliers d’un même pied ou un soulier et un sabot. Celà permettait de faire l’appel, mais pour le travail, c’était une torture supplémentaire puisque cela occasionnait des plaies aux jambes qui, à cause du manque de soins, s’envenimaient rapidement. Nombreuses sont les compagnes qui sont entrées au « Revier » pour des plaies aux jambes et qui n’en sont jamais ressorties.
M. Dubost : Que faisait-on aux internées qui se présentaient à l’appel sans chaussures ?
Mme V-C : Les internées Juives qui allaient à l’appel sans chaussures étaient immédiatement conduites au bloc 25.
M. Dubost : On les gazait donc ?
Mme V-C : On les gazait pour n’importe quoi. Leur situation du reste était absolument effroyable. Alors que nous étions entassées à 800 dans des blocs et que nous pouvions à peine nous remuer, elles étaient dans des blocs de dimensions semblables, à 1 500, c’est-à-dire qu’un grand nombre ne pouvait pas dormir la nuit, ou même s’étendre.
M. Dubost : Pouvez-vous parler du Revier ?
Mme V-C : Pour arriver au Revier, il fallait d’abord faire l’appel. Quel que soit l’état…
M. Dubost : Voulez-vous préciser ce qu’était le Revier dans le camp ?
Mme V-C : Le Revier était les blocs où l’on mettait les malades. On ne peut pas donner à cet endroit le nom d’hôpital, car cela ne correspond pas du tout à l’idée qu’on se fait d’un hôpital. Pour y aller, il fallait d’abord obtenir l’autorisation du chef de bloc, qui la donnait très rarement. Quand enfin on l’avait obtenue, on était conduit en colonne devant l’infirmerie où, par tous les temps, qu’il neige, ou qu’il pleuve, même avec 40° de fièvre, on devait attendre devant la porte de l’infirmerie, avant d’avoir pu y pénétrer. Du reste, même de faire la queue devant l’infirmerie était dangereux car, lorsque cette queue était trop grande, le SS passait, ramassait toutes les femmes qui attendaient et les conduisait directement au bloc 25.
M. Dubost : C’est-à-dire à la chambre à gaz ?
Mme V-C : C’est-à-dire à la chambre à gaz.
C’est pourquoi, très souvent les femmes préféraient ne pas se présenter au Revier, et elles mouraient au travail ou à l’appel. Après l’appel du soir, en hiver, quotidiennement on relevait des mortes qui avaient roulé dans les fossés. Le seul intérêt du Revier, c’est que, comme on était couché, on était dispensé de l’appel, mais on était couché dans des conditions effroyables, dans des lits de moins d’un mètre de large, à quatre, avec des maladies différentes, ce qui faisait que celles, qui étaient entrées pour des plaies aux jambes, attrapaient la dysenterie ou le typhus de leur voisine. Les paillasses étaient souillées, on ne les changeait que quand elles étaient complètement pourries. Les couvertures étaient si pleines de poux qu’on les voyait grouiller comme des fourmis.
Une de mes compagnes, Marguerite Corringer, me racontait que, pendant son typhus, elle ne pouvait pas dormir toute la nuit à cause des poux ; elle passait sa nuit à secouer sa couverture sur un papier, à vider les poux dans un récipient auprès de son lit, et ainsi pendant des heures. Il n’y avait pour ainsi dire pas de médicaments ; on laissait donc les malades couchées, sans soins, sans hygiène, sans les laver. On laissait les mortes pendant plusieurs heures couchées avec les malades, puis quand enfin on s’apercevait de leur présence, on les balançait simplement hors du lit et on les conduisait devant le bloc. Là, la colonne des porteuses de mortes venait les chercher sur de petits brancards, d’où la tête et les jambes pendaient. Du matin au soir, les porteuses de mortes faisaient le trajet entre le Revier et la morgue. Pendant les grandes épidémies de typhus des hivers 1943 et 1944, les brancards ont été remplacés par des chariots, car il y avait trop de mortes. Il y a eu, pendant ces périodes d’épidémie, de 200 à 350 mortes par jour.
M. Dubost : Combien mourait-il de gens à ce moment-là ?
Mme V-C : Pendant les grandes épidémies de typhus des hivers 1943-1944, de 200 à 350 suivant les jours.
M. Dubost : Le Revier était-il ouvert à toutes les internées ?
Mme V-C : Non, quand nous sommes arrivées, les Juives n’avaient pas le droit d’y aller, elles étaient directement conduites à la chambre à gaz.
Monsieur Dubost : Voulez-vous parler de la désinfection des blocs, s’il vous plaît ?
Mme V-C : De temps en temps, étant donné les tas de saletés qui occasionnaient des poux et par conséquent tant d’épidémies, on désinfectait les blocs en les gazant, mais ces désinfections causaient également un très grand nombre de morts parce que, pendant qu’on gazait le bloc, les prisonnières étaient conduites aux douches, puis on leur retirait leurs vêtements, qu’on passait à l’étuve… On les laissait toutes nues dehors attendre que les vêtements ressortent de l’étuve et on leur redonnait mouillés. On envoyait même les malades, quand elles pouvaient se tenir sur leurs jambes, aux douches. Il est évident qu’un très grand nombre mouraient en cours de route. Celles qui ne pouvaient pas bouger, étaient lavées toutes dans la même baignoire pendant la désinfection.
M. Dubost : Comment étiez-vous nourries ?
Mme V-C : Nous recevions 200 grammes de pain, trois quarts de litre ou un demi-litre – suivant les cas – de soupe au rutabaga et quelques grammes de margarine ou une rondelle de saucisson le soir. Cela pour le jour.
M. Dubost : Quel que soit le travail qui était exigé des internées ?
Mme V-C : Quel que soit le travail qui était exigé de l’internée. Certaines qui travaillaient à l’usine de l’« Union », une fabrique de munitions où elles faisaient des grenades et des obus, recevaient ce qu’on appelait un « zulage », c’est-à-dire un supplément, quand la norme était atteinte. Ces détenues faisaient, comme nous, l’appel le matin et le soir et elles étaient au travail 12 heures dans leur usine. Elles rentraient au camp après le travail et faisaient le trajet aller et retour à pied.
M. Dubost : Qu’était cette usine de l’« Union » ?
Mme V-C : C’était une fabrique de munitions. Je ne sais pas à quelle société elle appartenait. Cela s’appelait l’« Union ».
M. Dubost : C’était la seule usine ?
Mme V-C : Non, il y avait également une grande usine à Buna, mais comme je n’y ai pas travaillé, je ne sais pas ce qu’on y faisait. Les détenues qui étaient prises pour Buna ne revenaient plus dans notre camp.
M. Dubost : Voulez-vous parler des expériences si vous en avez été témoin ?
Mme V-C : En ce qui concerne les expériences, j’ai vu dans le Revier, car j’étais employée au Revier, la file des jeunes Juives de Salonique qui attendaient, devant la salle des rayons, pour la stérilisation. Je sais, par ailleurs, qu’on opérait également par castration dans le camp des hommes. En ce qui concerne les expériences faites sur des femmes, je suis au courant parce que mon amie, la doctoresse Hautval, de Montbéliard, qui est rentrée en France, a travaillé plusieurs mois dans ce bloc pour soigner les malades, mais elle a toujours refusé de participer aux expériences. On stérilisait les femmes, soit par piqûres, soit par opérations, ou également par rayons. J’ai vu et connu plusieurs femmes qui avaient été stérilisées. Il y avait parmi les opérées une forte mortalité. Quatorze Juives de France qui avaient refusé de se laisser stériliser ont été envoyées dans un commando de Strafarbeit, c’est-à-dire punition de travail.
M. Dubost : Revenait-on de ces commandos ?
Mme V-C : Rarement, tout à fait exceptionnellement.
M. Dubost : Quel était le but poursuivi par les SS ?
Mme V-C : Les stérilisations, ils ne s’en cachaient pas ; ils disaient qu’ils essayaient de trouver la meilleure méthode de stérilisation pour pouvoir remplacer, dans les pays occupés, la population autochtone par les Allemands, au bout d’une génération, une fois qu’ils auraient utilisé les habitants comme esclaves pour travailler pour eux.
M. Dubost : Au Revier, avez-vous vu des femmes enceintes ?
Mme V-C : Oui. Les femmes juives, quand elles arrivaient enceintes de peu de mois, on les faisait avorter. Quand la grossesse était près de la fin, après l’accouchement, on noyait les bébés dans un seau d’eau. Je sais cela parce que je travaillais au Revier, et que la préposée à ce travail était une sage-femme allemande, détenue de droit commun pour avoir pratiqué des avortements. Au bout d’un certain temps, un autre médecin est arrivé et, pendant deux mois, on n’a pas tué de bébés juifs. Mais, un beau jour, un ordre est arrivé de Berlin disant qu’il fallait de nouveau les supprimer. Alors, les mères et leurs bébés ont été appelées à l’infirmerie, elles sont montées en camion et on les a conduites aux gaz.
M. Dubost : Pourquoi dites-vous qu’un ordre est arrivé de Berlin ?
Mme V-C : Parce que je connaissais les détenues qui travaillaient au secrétariat des SS, en particulier, une Slovaque, nommée Herta Roth, qui travaille à l’heure actuelle à l’UNRRA à Bratislava.
M. Dubost : C’est elle qui vous l’a dit ?
Mme V-C : Oui. Et d’autre part, je connaissais également les hommes qui travaillaient au commando des gaz.
M. Dubost : Vous venez de parler des mères juives, y avait-il d’autres mères dans votre camp ?
Mme V-C : Oui, en principe, les femmes non juives accouchaient et on ne leur enlevait pas leurs bébés, mais, étant donné les conditions effroyables du camp, les bébés dépassaient rarement quatre à cinq semaines. Il y avait le bloc où se trouvaient les mères polonaises et russes. Un jour, les mère russes ayant été accusées de faire trop de bruit, on leur a fait faire l’appel toute la journée devant le bloc, toutes nues avec leurs bébés dans leurs bras.
M. Dubost : Quel était le régime disciplinaire du camp ? Qui assurait la surveillance et la discipline ? Quelles étaient les sanctions ?
Mme V-C : En général, les SS économisaient beaucoup de personnel à eux en employant des détenues pour la surveillance du camp. Ils ne faisaient que superviser. Ces détenues étaient prises parmi les filles de droit commun ou des filles publiques allemandes, et quelquefois d’autres nations, mais en majorité des Allemandes. On arrivait par la corruption et la délation, la terreur, à les transformer en bêtes humaines, et les détenues ont autant à s’en plaindre que des SS eux-mêmes. Elles frappaient autant que frappaient les SS et, en ce qui
concerne les SS, les hommes se conduisaient comme les femmes et les femmes étaient aussi sauvages que les hommes. Il n’y a pas de différence. Le système employé par les SS pour avilir les êtres humains au maximum en les terrorisant, et, par la terreur, en leur faisant faire des actes qui devaient les faire rougir eux-mêmes, arrivait à faire qu’ils ne soient plus des êtres humains. Et c’était cela qu’ils recherchaient ; il fallait énormément de courage pour résister à cette ambiance de terreur et de corruption.
M. Dubost : Qui distribuait les punitions
Mme V-C : Les chefs SS, les hommes et les femmes.
M. Dubost : En quoi consistaient les punitions ?
Mme V-C : En mauvais traitements corporels, en particulier, une des punitions les plus classiques était 50 coups de bâton sur les reins. Ces coups de bâton étaient donnés par une machine que j’ai vue ; c’était un système de balancements qui était manipulé par un SS. Il y avait aussi des appels interminables jour et nuit ou bien de la gymnastique ; il fallait se mettre à plat ventre, se relever, se mettre à plat ventre, se relever, pendant des heures, et quand on tombait, on était assommé de coups et transporté au bloc 25.
M. Dubost : Comment se comportaient les SS à l’égard des femmes ? Et les femmes SS ?
Mme V-C : Il y avait à Auschwitz une maison de tolérance pour les SS et également pour les détenus, fonctionnaires hommes, qu’on appelait des « Kapo ». D’autre part, quand les SS avaient besoin de domestiques, ils venaient, accompagnés de l’Obersaufseherin, c’est-à-dire la commandante femme du camp, choisir pendant la désinfection, et ils désignaient une petite jeune fille que l’Oberaufseherin faisait sortir des rangs. Ils la scrutaient, faisaient des plaisanteries sur son physique et, si elle était jolie et leur plaisait, ils l’engageaient comme bonne avec le consentement de l’Oberaufseherin qui leur disait qu’elle leur devait une obéissance absolue, quoi qu’ils lui demandent.
M. Dubost : Pourquoi venaient-ils pendant le désinfection ?
Mme V-C : Parce que pendant la désinfection, les femmes étaient nues.
M. Dubost : Ce système de démoralisation et de corruption étaitil exceptionnel ?
Mme V-C : Non, dans tous les camps où j’ai passé, le système était le même ; j’ai parlé à des détenues venues de camps où je n’avais pas été moi-même, et c’est toujours la même chose. Le système est exactement le même dans n’importe quel camp. Cependant il y a des variantes. Auschwitz, je crois, était l’un des plus durs, mais j’ai été ensuite à Ravensbrück ; là aussi, il y avait une maison de tolérance et là aussi on recrutait parmi les détenues.
M. Dubost : Selon vous, tout a été mis en oeuvre alors pour les faire déchoir à leurs propres yeux ?
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Que savez-vous du transport des Juifs, qui est arrivé presque en même temps que vous, venant de Romainville ?
Mme V-C : Quand nous avons quitté Romainville, on avait laissé sur place les Juives qui étaient à Romainville en même temps que nous ; elles ont été dirigées vers Drancy et sont arrivées à Auschwitz où nous les avons retrouvées trois semaines plus tard, trois semaines après nous.
Sur 1 200 qu’elles étaient, il n’en est entré dans le camp que 125, les autres ont été dirigées sur les gaz tout de suite. Sur ces 125, au bout d’un mois, il n’en restait plus une seule.
Les transports se pratiquaient de la manière suivante au début, quand nous sommes arrivés : quand un convoi de Juifs arrivait, on sélectionnait : d’abord les vieillards, les vieilles femmes, les mères et les enfants qu’on faisait monter en camions, ainsi que les malades ou ceux qui paraissaient de constitution faible. On ne prenait que les jeunes femmes et jeunes filles, et les jeunes gens qu’on envoyait au camp des hommes. Il arrivait, en général, sur un transport de 1 000 à 1 500, qu’il en entrait rarement plus de 250 – et c’est tout à fait un maximum – dans le camp. Le reste était directement dirigé aux gaz. A cette sélection également, on choisissait les femmes en bonne santé, entre 20 et 30 ans, qu’on envoyait au bloc des expériences, et les jeunes filles et les femmes un peu plus agées ou celles qui n’avaient pas été choisies dans ce but étaient envoyées au camp où elles étaient, comme nous, rasées et tatouées. Il y a eu, également pendant le printemps 1944, un bloc de jumeaux. C’était la période où sont arrivés d’immenses transports de Juifs hongrois : 700 000 environ. Le Dr Mengele, qui faisait des expériences, gardait de tous les transports, les enfants jumeaux et en général les jumeaux, quel que soit leur âge, pourvu qu’ils soient là tous les deux. Alors, dans ce bloc, il y a avait des bébés et des adultes, par terre. Je ne sais pas, en dehors des prises de sang et des mesures, je ne sais pas ce qu’on leur faisait.
M. Dubost : Etes-vous témoin direct de la sélection à l’arrivée des convois ?
Mme V-C : Oui, parce que quand nous avons travaillé au bloc de la couture en 1944, notre bloc où nous habitions était en face de l’arrivée du train. On avait perfectionné le système : au lieu de faire la sélection à la halte d’arrivée, une voie de garage menait le train presque jusqu’à la chambre à gaz et l’arrêt, c’est-à-dire à 100 mètres de la chambre à gaz, était juste devant notre bloc, mais naturellement, séparé par deux rangées de fil de fer barbelé. Nous voyions donc les wagons déplombés, les soldats sortir les hommes, les femmes et les enfants des wagons, et on assistait aux scènes déchirantes des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d’abandonner leurs jeunes filles, puisqu’elles entraient dans le camp, tandis que les mères et les enfants étaient dirigés vers la chambre à gaz. Tous ces gens-là ignoraient le sort qui leur était réservé. Ils étaient seulement désemparés parce qu’on les séparait les uns des autres, mais ils ignoraient qu’ils allaient à la mort.
Pour rendre l’accueil plus agréable, à cette époque, c’est-à-dire en juin, juillet 1944, un orchestre composé de détenues, toutes jeunes et jolies, habillées de petites blouses blanches et de jupes bleu marine, jouait, pendant la sélection à l’arrivée des trains, des airs gais comme la Veuve Joyeuse, la Barcarolle, des Contes d’Hoffmann, etc. Alors, on leur disait que c’était un camp de travail, et comme ils n’entraient pas dans le camp, il ne voyaient que la petite plateforme entourée de verdure où se trouvait l’orchestre. Evidemment, ils ne pouvaient pas se rendre compte de ce qui les attendait. Ceux qui étaient sélectionnés pour les gaz, c’est-à-dire les vieillards, les enfants et les mères, étaient conduits dans un bâtiment en briques rouges.
M. Dubost : Ceux-là n’étaient pas immatriculés ?
Mme V-C : Non.
M. Dubost : Ils n’étaient pas tatoués ?
Mme V-C : Non. Ils n’étaient même pas comptés.
M. Dubost : Vous avez été tatouée ?
Mme V-C : Oui. Voyez. (Le témoin montre son bras).
Ils étaient conduits dans un bâtiment en briques rouges qui portait les lettre « Bad », c’est-à-dire « bains ». Là, au début, on les faisait se déshabiller, et on leur donnait une serviette de toilette avant de les faire entrer dans la soi-disant salle de douches. Par la suite, à l’époque des grands transports de Hongrie, on n’avait plus le temps de jouer ou de simuler. On les déshabillait brutalement et je sais ces détails car j’ai connu une petite Juive de France, qui habitait avec sa famille Place de la République…
M. Dubost : A Paris ?
Mme V-C : A Paris… qu’on appelait la petite Marie et qui était la seule survivante d’une famille de neuf. Sa mère et ses sept frères et sœurs avaient été gazés à l’arrivée. Lorsque je l’ai connue, elle était employée pour déshabiller les bébés avant la chambre à gaz. On faisait pénétrer les gens, une fois déshabillés, dans une pièce qui ressemblait à une salle de douches, et par un orifice dans le plafond, on lançait les capsules de gaz. Un SS regardait par un hublot l’effet produit. Au bout de cinq à sept minutes, lorsque le gaz avait fait son œuvre, il donnait le signal pour qu’on ouvre les portes. Des hommes avec des masques à gaz – ces hommes étaient des détenus - pénétraient dans la salle et retiraient les corps. Ils nous racontaient que les détenus devaient souffrir avant de mourir, car ils étaient agrippés les uns aux autres en grappes et on avait beaucoup de mal à les séparer. Après cela, une équipe passaitpour arracher les dents en or et les dentiers. Et encore une fois, quand les corps étaient réduits en cendres, on passait encore au tamis pour essayer de récupérer l’or.
Il y avait à Auschwitz huit fours crématoires. Mais à partir de 1944, ce n’était pas suffisant. Les SS ont fait creuser par les détenus de grandes fosses dans lesquelles ils mettaient des branchages arrosés d’essence qu’ils enflammaient. Ils jetaient les corps dans ces fosses. de notre bloc, nous voyions, à peu près trois quarts d’heure ou une heure après l’arrivée d’un transport, sortir les grandes flammes du four crématoire et le ciel s’embraser par les fosses.
Une nuit, nous avons été réveillées par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin, par les hommes qui travaillaient au Sonderkommando (le commando des gaz) que la veille, n’ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans la fournaise.
M. Dubost : Pouvez-vous parler des sélections, s’il vous plaît, qui étaient faites à l’entrée de l’hiver ?
Mme V-C : Chaque année, vers la fin de l’automne, on faisait dans les Revier de grandes sélections. Le système semblait être le suivant. (Je dis cela parce que, sur le temps que j’ai passé à Auschwitz, j’ai pu en faire la constatation, et d’autres qui sont restées plus longtemps que moi ont fait la même constatation).
Au printemps, à travers toute l’Europe, on raflait des hommes et des femmes, qu’on envoyait à Auschwitz. On ne gardait que ceux qui étaient assez forts pour travailler tout l’été. Pendant cette période, naturellement, il en mourait tous les jours. Mais les plus robustes, qui arrivaient à tenir six mois, étaient au bout de ce temps si épuisés qu’ils entraient à leur tour au Revier. C’est à ce moment-là qu’on faisait de grandes sélections, en automne, pour ne pas avoir à nourrir pendant l’hiver des bouches inutiles.
Toutes les femmes qui étaient trop maigres étaient envoyées au gaz, toutes celles qui avaient des maladies un peu longues. Mais on gazait les Juives pour presque rien : par exemple, on a gazé celles du bloc de la gale, alors que chacun sait que la gale se guérit en trois jours si on la soigne. Je me souviens du bloc des convalescentes du typhus où, sur 500 malades, on en a envoyé 450 aux gaz.
Pendant Noël 1944, non 1943, à Noël 1943, alors que nous étions en quarantaine, nous avons vu, car nous étions en face du bloc 25, amener les femmes toutes nues dans le bloc. Ensuite, on faisait venir les camions, des camions non bâchés sur lesquels on empilait des femmes nues, autant que les camions pouvaient en contenir, et puis, chaque fois que le camion s’ébranlait, le fameux Hessler – qui a été au procès de Luneburg un des condamnés – courait derrière le camion, et, avec sa trique, il battait à coups redoublés ces femmes nues qui s’en allaient à la mort. Elles savaient qu’elles partaient aux gaz, alors elles essayaient de s’échapper. On les massacrait. Elles essayaient de sauter du camion, et nous, de notre bloc, nous voyions passer le camion, et nous entendions la lugubre clameur de toutes ces femmes qui partaient, en sachant qu’elles devaient être gazées, et beaucoup d’entre elles auraient très bien pu vivre, elles n’avaient que la gale, ou simplement un peu trop de sousalimentations.
M. Dubost : Vous nous avez dit, Madame, tout à l’heure, que les déportés étaient, dès leur descente du train, et sans être comptés même, envoyés à la chambre à gaz. Que devenaient leurs vêtements, leurs bagages ?
Mme V-C : Quand les Juifs arrivaient – parce que pour les non Juifs ils devaient porter eux-mêmes leurs bagages et étaient rangés dans des blocs à part – ils devaient tout laisser sur le quai à l’arrivée, ils étaient déshabillés avant d’entrer et leurs habits, ainsi que tout ce qu’ils avaient apporté et laissé sur le quai, étaient transportés dans de grandes baraques, et triés par le commando qu’on appelait « Canada ». Là, on faisait des triages et tout était expédié vers l’Allemagne : les bijoux, les manteaux de fourrure, etc… Comme on envoyait à Auschwitz des Juives avec toute leur famille, en leur disant que ce serait une sorte de ghetto et qu’il fallait qu’elles emportent tout ce qu’elles possédaient, elles amenaient donc des richesses considérables. Je me souviens, en ce qui concerne les Juives de Salonique, quand elles sont arrivées, on leur a donné une carte postale avec inscrit dessus comme lieu d’expédition : Waldsee, lieu qui n’existait pas, et un texte imprimé, qu’elles devaient envoyer à leur famille, disant : « Nous sommes très bien ici, il y a du travail, on est bien traité, nous attendons votre arrivée ». J’ai vu moi-même les cartes en question, et les Schreiberinnen, c’est-àdire les secrétaires de bloc, avaient l’ordre de les distribuer parmi les détenues, pour qu’elles les envoient à leurs familles, et je sais qu’à la suite de cela des familles se sont présentées. Je ne connais cette histoire que pour la Grèce. Je ne sais pas si elle s’est pratiquée ailleurs, mais, en tout cas, pour la Grèce (également pour la Slovaquie), des familles se sont présentées au bureau de recrutement, à Salonique, pour aller rejoindre les leurs, et je me souviens d’un professeur de lettres de Salonique qui a vu avec horreur arriver son père.
M. Dubost : Voulez-vous parler des camps de Tziganes ?
Mme V-C : Il y avait à côté de notre camp, de l’autre côté des fils de fer barbelés séparés par trois mètres, deux camps, un camp de Tziganes qui a été, en 1944, vers le mois d’août, entièrement gazé. C’était des Tziganes de toute l’Europe, y compris l’Allemagne. Egalement de l’autre côté, il y avait ce que l’on appelait le « camp familial ». C’étaient des Juifs de Theresienstatd, du ghetto de Theresienstatd, qui avaient été conduits là-bas, et, contrairement à nous, ils n’étaient ni tatoués, ni rasés, on ne leur enlevait pas leurs vêtements, ils ne travaillaient pas. Ils ont vécu comme cela six mois, et au bout de six mois, on a gazé tout le « camp familial ». Cela représentait à peu près 6 000 ou 7 000 Juifs et, quelques jours après, d’autres grands transports sont arrivés de Theresienstatd également, avec des familles, et, au bout de six mois également, elles ont été gazées comme les premières.
M. Dubost : Voudriez-vous, Madame, donner quelques précisions sur ce que vous avez vu lorsque vous étiez sur le point de quitter ce camp, et dans quelles conditions vous l’avez quitté ?
Mme V-C : Nous avons été mises en quarantaine avant de quitter Auschwitz.
M. Dubost : A quelle époque était-ce ?
Mme V-C : Nous avons été dix mois en quarantaine, du 15 juillet 1943, oui, jusqu’en mai 1944, et puis nous sommes retournées pendant deux mois dans le camp et ensuite, nous sommes parties pour Ravensbrück.
M. Dubost : C’étaient toutes les Française survivantes de votre convoi ?
Mme V-C : Oui, toutes les Françaises survivantes de notre convoi. Nous avons appris, par les Juives arrivées de France vers juillet 1944, qu’une grande campagne avait été faite à la radio de Londres où l’on parlait de notre transport, en citant Maï Politzer, Danielle Casanova, Hélène Salomon-Langevin, et moi-même, et à la suite de cela, nous savons que des ordres ont été donnés à Berlin d’effectuer le transport de Françaises dans de meilleures conditions. Nous avons donc été en quarantaine. C’était un bloc situé en face du camp, à l’extérieur des fils de fer barbelés. Je dois dire que c’est à cette quarantaine que les survivantes doivent la vie, car au bout de quatre mois nous n’étions plus que 52.
Il est donc certain que nous n’aurions pas survécu dix-huit mois de cette vie, si nous n’avions pas eu ces dix mois de quarantaine. Cette quarantaine était faite parce que le typhus exanthématique régnait à Auschwitz. On ne pouvait quitter le camp pour être libérée ou transférée dans un autre camp, ou pour aller au Tribunal, qu’après avoir passé quinze jours en quarantaine, ces quinze jours étant la durée d’incubation du typhus exanthématique. Aussi, dès que les papiers arrivaient, annonçant qu’une détenue serait probablement libérée, on l’envoyait en quarantaine, où elle restait jusqu’à ce que l’ordre de libération soit signé. Cela durait parfois plusieurs mois, mais au minimum quinze jours. Or, durant cette période, il y a eu une politique de libération des détenues de droit commun et des associales allemandes, pour les envoyer comme main-d’oeuvre dans les usines d’Allemagne. Il est donc impossible d’imaginer que, dans toute l’Allemagne, on pouvait ignorer qu’il y avait des camps de concentration, et ce qui s’y passait, puisque ces femmes sortaient de là, et qu’il est difficile de croire qu’elles n’ont jamais parlé. D’autre part, dans les usines où travaillaient des détenues, les Vorarbeiterinnen, c’est-àdire les contremaîtresses, étaient des civiles allemandes qui étaient en contact avec les détenues, et qui pouvaient leur parler. Les Aufseherinnen d’Auschwitz, qui sont venues après chez Siemens à Ravensbrück comme Aufseherinnen, étaient d’anciennes travailleuses libres de chez Siemens à Berlin, et elles se sont retrouvées avec les contremaîtresses qu’elles avaient connues à Berlin, et elles leur racontaient devant nous ce qu’elles avaient vu à Auschwitz. On ne peut donc pas croire que cela ne se savait pas en Allemagne.
Lorsque nous avons quitté Auschwitz nous n’en croyions pas nos yeux, et nous avions le coeur très serré en voyant ce petit groupe de 49 que nous étions devenues, par rapport au groupe de 230 qui était entré dix-huit mois plus tôt.
Mais nous avions l’impression de sortir de l’enfer, et pour la première fois, un espoir de revivre et de revoir le monde nous était donné.
M. Dubost : Où vous a-t-on envoyée, Madame ?
Mme V-C : En sortant d’Auschwitz nous avons été envoyées à Ravensbrück. Là, nous avons été conduites au bloc des N.N., qui voulait dire « Nacht und Nebel » c’est-à-dire « le secret ». dans ce bloc, avec nous, il y avait des Polonaises, portant le matricule 7.000, et quelques-unes qu’on appelait les « lapins », parce qu’elles avaient servi de cobayes. On choisissait dans leurs transports des jeunes filles ayant les jambes bien droites et étant elles-mêmes bien saines, et on leur faisait subir les opérations. A certaines, on a enlevé des parties d’os dans les jambes ; à d’autres, on a fait des injections, mais je ne saurais pas dire de quoi. Il y avait parmi les opérées une grande mortalité. Aussi les autres, quand on est venu les chercher pour les opérer, ont-elles refusé de se rendre au Revier. On les a conduites de force au cachot, et c’est là que le professeur venu de Berlin les opérait, en uniforme, sans prendre aucune précaution aseptique, sans mettre de blouse, sans se laver les mains. Il y a des survivantes de ces « lapins », elles souffrent encore énormément maintenant. Elles ont, par périodes, des suppurations et comme on ne sait pas quels traitements elles ont subis, il est très difficile de les guérir.
M. Dubost : Les internées étaient-elles tatouées à leur arrivée ?
Mme V-C : Non, à Ravensbrück, on n’était pas tatoué, mais par contre on passait un examen gynécologique, et comme on ne prenait aucune précaution et qu’on se servait des mêmes instruments, il y avait des contagions de maladies, étant donné que les détenues politiques étaient mélangées. Dans le bloc 32, où nous étions, il y avait également des prisonnières de guerre russes qui avaient refusé de travailler volontairement dans des usines de munitions. Elles avaient été conduites à cause de cela à Ravensbrück. Comme elles continuaient de refuser, on leur a fait subir toutes sortes de brimades, telles que de les laisser debout devant le bloc sans manger. Une partie a été envoyée en transport à Barth. Une autre a été employée pour porter les bidons dans le camp. Il y avait également, au Strafblock et au Bunker, des détenues ayant refusé de travailler pour les usines de guerre.
M. Dubost : Vous parlez là des prisons du camp ?
Mme V-C : Des prisons du camp. Du reste, la prison du camp, je l’ai visitée, c’était une prison civile, une vraie prison.
M. Dubost : Combien y a-t-il eu de Français dans ce camp ?
Mme V-C : De 8 000 à 10 000.
M. Dubost : Combien y a-t-il eu de femmes en tout ?
Mme V-C : Au moment de la libération, le chiffre matricule était 105 000 et quelques. Il y a eu également, dans le camp, des exécutions. On appelait les numéros à l’appel le matin, puis elles partaient à la Kommandantur et on ne les revoyait pas. Quelques jours après, les vêtements redescendaient à l’Effektenkammer, où l’on gardait les habits des détenues, et au bout d’un certain temps, leurs fiches disparaissaient des fichiers du camp.
M. Dubost : Le système de détention était le même à Auschwitz ?
Mme V-C : A Auschwitz, visiblement le but était l’extermination. On ne s’occupait pas du rendement. On était battu pour rien du tout. Il suffisait d’être debout du matin au soir, mais le fait que l’on porte une brique ou dix briques n’avait pas d’importance. On se rendait bien compte qu’on utilisait le matériel humain esclave, et pour le faire mourir, c’était cela le but ; alors qu’à Ravensbrück le rendement jouait un grand rôle.
C’était un camp de triage. Quand des transports arrivaient à Ravensbrück ils étaient expédiés très rapidement, soit dans des usines de munitions, soit dans des poudreries, soit pour faire des terrains d’aviation, et les derniers temps pour creuser des tranchées. Pour partir dans les usines, cela se pratiquait de la façon suivante : les industriels ou leurs contremaîtres, ou leurs responsables venaient eux-mêmes, accompagnés des SS, choisir et sélectionner. On avait l’impression d’un marché d’esclaves : ils tâtaient les muscles, regardaient la bonne mine, puis ils faisaient leur choix. Ensuite, on passait devant le médecin, déshabillée, et il décidait si on était apte ou non à partir au travail dans les usines. Les derniers temps, la visite au médecin n’était plus que pro forma, car on prenait n’importe qui. Le travail était exténuant, surtout à cause du manque de nourriture et de sommeil, puisqu’en plus des douze heures effectives de travail, il fallait faire l’appel le matin et le soir…
A Ravensbrück même, il y avait l’usine Siemens où l’on fabriquait du matériel téléphonique, et des instruments pour la radio des avions. Puis, il y avait à l’intérieur du camp des ateliers de camouflage d’uniformes et de différents ustensiles utilisés par les soldats ? Un de ceux que je connais le mieux…
Le Président : Je pense qu’il vaut mieux suspendre l’audience pendant dix minutes. (L’audience est suspendue)
M. Dubost : Avez-vous vu, Madame, des chefs SS et des membres de la Wehrmacht faire des visites dans les camps de Ravensbrück et d’Auschwitz, pendant que vous y étiez ?
Mme V-C : Oui.
M. Dubost : Savez-vous si des personnalités du Gouvernement allemand sont venues visiter ces camps ?
Mme V-C : Je ne le sais que pour Himmler. En-dehors de Himmler, je ne sais pas.
M. Dubost : Quels étaient les gardiens de ces camps ?
Mme V-C : Au début, c’étaient seulement des SS. A partir du printemps 1944, les jeunes SS, dans beaucoup de compagnies, ont été remplacés par des vieux de la Wehrmacht ; à Auschwitz et également à Ravensbrück, nous avons été gardées par des soldats de la Wehrmacht, à partir de 1944.
M. Dubost : Vous portez témoignage, par conséquent, que sur l’ordre du Grand Etat-Major (O.K.W) allemand, l’Armée allemande a été mêlée aux atrocités que vous nous avez décrites ?
Mme V-C : Evidemment, puisque nous étions gardées également par la Wehrmacht, cela ne pouvait pas être sans ordres.
M. Dubost : Votre témoignage est formel, et il atteint à la fois les SS et l’Armée ?
Mme V-C : Absolument.
M. Dubost : Voudriez-vous parler de l’arrivée à Ravensbrück, pendant l’hiver 1944, des Juives hongroises qui avaient été arrêtées en masse. Vous étiez à Ravensbrück, c’est un fait dont vous pouvez témoigner ?
Mme V-C : Oui, naturellement, j’y ai assisté. Il n’y avait plus de place dans les blocs ; les détenues couchaient déjà à quatre par lit. Alors il a été dressé au milieu du camp une grande tente. Dans cette tente, on avait mis de la paille, et les détenues hongroises ont été conduites sous cette tente. Elles étaient dans un état effroyable. Il y avait énormément de pieds gelés, parce qu’elles avient été évacuées de Budapest, et elles avaient fait une grande partie du trajet à pied dans la neige. Un grandnombre étaient mortes. Celles qui sont arrivées à Auschwitz ont donc été conduites sous cette tente, et là, il en mourait énormément. Tous les jours, une équipevenait rechercher les cadavres sous la tente. Un jour, en revenant à mon bloc, qui était voisin, pendant le nettoyage…
Le Président : Parlez-vous de Ravensbrück ou d’Auschwitz ?
Mme V-C : Je parle de Ravensbrück maintenant. C’était en hiver 1944, je crois, à peu près en novembre ou décembre. Je ne peux pas préciser le mois, parce que, dans les camps de concentration, c’est très difficile de donner une date précise, étant donné qu’à un jour de torture succédait un jour de torture égal ;la monotonie rend très difficile les points de repère. Je dis donc qu’un jour, en passant devant la tente, au moment où on la nettoyait, j’ai vu un tas de fumier qui fumait, et tout d’un coup, j’ai réalisé que c’était du fumier humain, car les malheureuses n’avaient plus la force de se traîner jusqu’aux lieux d’aisance. Elles pourrissaient donc dans cette saleté.
M. Dubost : Dans quelles conditions travaillait-on à l’atelier où l’on fabriquait des vestes
Mme V-C : A l’atelier des uniformes…
M. Dubost : C’était l’atelier du camp ?
Mme V-C : C’était l’atelier du camp qu’on appelait la « Schneiderei I ». On fabriquait 200 vestes ou pantalons par jour. Il y avait deux équipes, une de jour et une de nuit, douze heures de travail par équipe. L’équipe de nuit, au début à minuit, lorsque la norme était atteinte, mais dans ce cas seulement, touchait une mince tartine de pain. Par la suite cela a été supprimé. Le travail était à une cadence effrénée, les détenues ne pouvaient même pas se rendre au lavabo. Pendant la nuit et le jour, elles étaient effroyablement battues, tant par les SS femmes que par les hommes, parce qu’un aiguille cassait, parce que le fil était de mauvaise qualité, parce que la machine s’arrêtait, ou tout simplement parce quelles avient une tête qui ne plaisait pas à ces messieurs ou ces dames. Vers la fin de la nuit, on voyait qu’elles étaient si épuisées que chaque effort leur coûtait. leur front perlait de sueur. elles ne voyaient presque plus clair. quand la norme n’était pas atteinte, le chef de l’atelier Binder se précipitait et battait à tour de bras l’une après l’autre, toute la rangée des femmes de la chaîne, ce qui fait que les dernières attendaient, pétrifiées de terreur, que leur tour arrive.
Quand on voulait aller au Revier, il fallait avoir l’autorisation des SS, qui la donnaient très rarement, et même dans ce cas, si le médecin donnait une dispense de travail de quelques jours, il arrivait couramment que les SS viennent rechercher la malade dans son lit pour la remettre à sa machine. L’atmosphère était effroyable, parce qu’à cause de « l’occultation », la nuit, on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres. Alors, 600 femmes travaillaient pendant 12 heures sans aucune ventilation. Toutes celles qui travaillaient à la Schneiderei devenaient squelettiques au bout de quelques mois, elles commençaient à tousser, leur vue baissait, elles avaient des tics nerveux, causés par la peur des coups.
Je connais bien les conditions de cet atelier, car ma petite amie Marie Rubiano, une petite Française qui, venant de passer trois ans à la prison de Kottbus, en arrivant à Ravensbrück avait été envoyée à la Schneiderei, et chaque soir, elle me racontait son martyre. Un jour, épuisée, elle a obtenu d’aller au revier et comme ce jour-là, la « Schwester » allemande, Erica, était de moins mauvaise humeur que de coutume, on l’a passée à la radio. Les deux poumons étaient atteints très gravement, elle a été envoyée à l’horrible bloc 10, le bloc des tuberculeuses. ce bloc était particulièrement effroyable, parce que les tuberculeuses n’étant pas considérées comme main d’oeuvre récupérable, on ne les soignait pas, et il n’y avait même pas de personnel assez nombreux pour les laver. Il n’y avait pour ainsi dire pas de médicaments. La petite Marie a été mise dans la chambre des bacillaires, c’est-à-dire celles qu’on considérait comme perdues. Elle y a passé quelques semaines, et elle n’avait même plus le courage de lutter pour vivre. Il faut dire que l’atmosphère de cette salle est particulièrement déprimante. Elles étaient très nombreuses, plusieurs par lit, dans des lits de trois étages, dans une atmosphère surchauffée, couchées entre détenues de différentes nationalités, ce qui faisait qu’elles ne pouvaient même pas se parler entre elles. Aussi, le silence de cette antichambre de la mort n’était-il coupé que par les glapissements des associales allemandes qui faisaient le service, et de temps en temps par le sanglot etouffé d’une petite fille qui pensait à sa mère, à son pays qu’elle ne reverrait jamais. Pourtant, Marie Rubiano ne mourant pas assez vite au gré des SS, un jour, le Dr Winkelmann, le spécialiste des sélections à Ravensbrück, l’a inscrite sur la liste noire, et le 9 février 1945, avec 72 autres tuberculeuses, dont 6 Françaises, elle a été hissée dans le camion pour la chambre à gaz.
Durant cette période, dans tous les Revier, on envoyait aux gaz toutes les malades qu’on pensait ne plus pouvoir utiliser pour le travail. La chambre à gaz à Ravensbrück était juste derrière le mur du camp, à côté du four crématoire. Quand les camions venaient chercher les malades, nous entendions le bruit du moteur à travers le camp et il s’arrêtait juste à côté du four crématoire dont la cheminée dépassait les hauts murs du camp. A la libération, je me suis rendue dans ces lieux et j’ai visité la chambre à gaz qui était une baraque en planches hermétiquement fermée et, à l’intérieur, il y avait encore l’odeur désagréable des gaz. Je sais qu’à Auschwitz, les gaz étaient les mêmes que ceux employés contre les poux et ils laissaient comme trace de petits cristaux vert pâle, qu’après avoir ouvert les fenêtres du bloc, on balayait. Je sais ces détails parce que les hommes utilisés à la désinfection des blocs contre les poux étaient en contact avec ceux qui gazaient les êtres humains, et ils leur ont dit que c’étaient les mêmes gaz qui étaient employés.
M. Dubost : Etait-ce le seul moyen utilisé pour exterminer les internés, à Ravensbrück ?
Mme V-C : Au bloc 10, on avait expérimenté également une poudre blanche un jour, la Schwester allemande Martha est arrivée dans le bloc et a distribué, à une vingtaine de malades, une poudre. A la suite de cela, les malades se sont endormies profondément : quatre ou cinq ont été prises de vomissements, c’est ce qui leur a sauvé la vie ; dans le courant de la nuit, peu à peu les ronflements se sont arrêtés et les malades étaient mortes. Je sais cela parce que j’allais chaque jour visiter des Françaises dans ce bloc ; deux des infirmières étaient françaises et la doctoresse Louise Le Porz, de Bordeaux, qui est rentrée, pourrait également en témoigner.
M. Dubost : Etait-ce fréquent ?
Mme V-C : Durant mon séjour, cet exemple a été le seul à l’intérieur du revier, mais on employait également ce système au Jugendlager, ainsi appelé parce que c’était un ancien pénitencier de jeunes délinquantes allemandes. Vers le début de l’année 1945, le Dr Winkelmann, ne se contentant plus de faire des sélections dans le Revier, en faisait également dans les blocs ; toutes les détenues devaient faire l’appel, les pieds nus, et montrer leur poitrine et leurs jambes. Toutes celles qui étaient trop agées, malades, trop maigres, ou qui avaient les jambes gonflées d’oedème, étaient mises de côté, puis envoyées dans ce Jugendlager à un quart d’heure du camp de Ravensbrück.
Je l’ai visité à la libération : on avait fait passer dans les blocs un ordre, disant que les vieilles femmes et les malades qui ne pouvaient pas travailler devaient se faire inscrire pour le Jugendlager, où elles seraient beaucoup mieux, où elles ne travailleraient pas, et où il n’y aurait pas d’appel. ; nous l’avons su, par la suite par des employés qui travaillaient au Jugendlager, dont la chef de camp, une Autrichienne que je connaissais depuis Auschwitz, nommée Betty Wentz, et par les quelques survivantes, dont Irène Ottelard, une Française habitant Drancy, 17, rue de la Liberté, qui a été rapatriée en même temps que moi et que j’avais soignée après la libération ; par elles, nous avons eu des détails sur le Jugendlager.
M. Dubost : Pouvez-vous me dire, Madame, si vous pouvez répondre à cette question : les médecins SS qui procédaient aux sélections agissaientils de leur propre mouvement ou conformément à des ordres reçus
Mme V-C : Ils agissaient conformément à des ordres reçus, puisque l’un d’eux, le Dr Lukas, ayant refusé de participer aux sélections, a été retiré du camp et on a envoyé de Berlin le Dr Winkelmann à sa place.
M. Dubost : Etes-vous témoin personnel de ces faits ?
Mme V-C : C’est lui qui l’a dit en s’en allant, à la chef du bloc 10 et à la doctoresse Louise Le Porz.
M. Dubost : Pourriez-vous nous donner quelques renseignements sur les conditions dans lesquelles vivaient les hommes du camp voisin à Ravensbrück, au lendemain de la libération, lorsque vous avez pu les voir ?
Mme V-C : Je crois qu’il vaut mieux parler d’abord du Jugendlager, puisque chronologiquement, cela se passe avant.
M. Dubost : Si vous voulez, bien.
Mme V-C : Au Jugendlager, les vieilles femmes et les malades qui étaient parties de notre camp ont été mises dans des blocs où il n’y avait pas d’eau et pas de commodités, sur des paillasses par terre, si serrées qu’on ne pouvait pas passer entre elles, ce qui faisait que la nuit, on ne pouvait pas dormir à cause du va-et-vient, et que les détenues se souillaient les unes les autres en passant. Les paillasses étaient pourries et pullulaient de poux, les détenues qui pouvaient se tenir debout faisaient l’appel pendant plusieurs heures jusqu’à ce qu’elles s’écroulent. Au mois de février, on leur a retiré leurs manteaux, mais elles continuaient à faire l’appel dehors, ce qui a beaucoup augmenté la mortalité. Elles ne recevaient comme nourriture qu’une mince tranche de pain et un demi-quart de soupe au rutabaga, et comme boisson, pour 24 heures, un demiquart de tisane. Elles n’avaient pas d’eau pour boire, pour se laver ou pour laver leurs gamelles. Il y avait également au Jugendlager un Revier où l’on mettait toutes celles qui ne pouvaient pas se tenir debout. Pendant les appels, périodiquement, l’Aufseherin choisissait des détenues que l’on déshabillait en ne leur laissant que leur chemise ; on leur rendait leur manteau pour monter en camion et elles partaient pour les gaz ; quelques jours après, les manteaux revenaient à la Kammer, c’est-à-dire à l’entrepôt de vêtements, et les fiches étaient marquées « Mittwerda ».
Les détenues qui travaillaient aux fichiers nous ont dit que le mot « Mittwerda » n’existait pas et que c’était une nomenclature pour les gaz. Au Revier, on distribuait périodiquement de la poudre blanche et les malades mouraient comme celles du bloc 10 dont j’ai parlé tout à l’heure. On faisait…
Le Président : Les conditions du camp de Ravensbrück semblent être les mêmes que celles d’Auschwitz ; serait-il possible, après avoir entendu ces détails, de s’occuper de la question de façon plus générale, à moins qu’il n’y ait une différence substantielle entre Ravensbrück et Auschwitz ?
M. Dubost : Je crois qu’il y a une différence qui nous a été exposée par le témoin et qui est la suivante : c’est qu’à Auschwitz, les internées étaient exterminées purement et simplement, il ne s’agissait que d’un camp d’extermination, tandis qu’à Ravensbrück, elles étaient internées pour travailler, elles étaient exténuées de travail jusqu’à ce qu’elles en meurent.
Le Président : S’il y a d’autres différences entre les deux camps, sans doute demanderez-vous au témoin ces différences
M. Dubost : Je n’y manquerai pas.
Le Président : Pouvez-vous indiquer au Tribunal dans quel état se trouvait le camp des hommes au moment de la libération et combien il restait de survivants ?
Mme V-C : Lorsque les Allemands sont partis, ils ont laissé 2 000 femmes malades et un certain nombre de volontaires dont moi-même, pour les soigner ; ils nous ont laissées sans eau et sans lumière ; heureusement les Russes sont arrivés le lendemain. Nous avons donc pu aller jusqu’au camp des hommes et là, nous avons trouvé un spectacle indescriptible ; ils étaient depuis cinq jours sans eau ; il y avait 800 malades graves, trois médecins et sept infirmières qui n’arrivaient pas à retirer les morts de parmi les malades. Nous avons pu, grâce à l’Armée Rouge, transporter ces malades dans des blocs propres et leur donner des soins et de la nourriture, mais malheureusement, je ne peux donner le chiffre que pour les Français : il y en avait 400 quand nous avons trouvé le camp, et il n’y en a que 150 qui ont pu regagner la France ; pour les autres, il était trop tard, malgré les soins…
Le Président : Avez-vous assisté à des exécutions et dans quelles conditions étaient-elles faites au camp ?
Mme V-C : Je n’ai pas assisté aux exécutions, je sais seulement que la dernière qui a eu lieu, c’est le 22 avril, huit jours avant l’arrivée de l’Armée Rouge ; on envoyait les détenues, comme je l’ai dit, à la Kommandantur puis leurs vêtements revenaient et on retirait leur carte du fichier.
Le Président : La situation de ce camp était-elle exceptionnelle ? Ou pensezvous qu’il s’agisse d’un système ?
Mme V-C : Il est difficile de donner une idée juste des camps de concentration quand on n’y a pas été soi-même, parce qu’on ne peut pas donner l’impression de cette longue monotonie, et quand on demande ce qui était le pire, il est impossible de répondre, parce que tout était atroce. C’est atroce de mourir de faim, de mourir de soif, d’être malade, de voir mourir autour de soi ses compagnes, sans rien pouvoir faire, de penser à ses enfants, à son pays qu’on ne reverra pas, et par moments nous nous demandions nous-mêmes si ce n’était pas un cauchemar tellement cette vie nous semblait irréelle dans son horreur. Nous n’avions qu’une volonté pendant des mois et des années, c’était de sortir à quelques-unes vivantes pour pouvoir dire au monde ce que c’est que les bagnes nazis : partout, à Auschwitz comme à Ravensbrück – et mes compagnes qui ont été dans d’autres camps rapportent la même chose – cette volonté systématique et implacable d’utiliser les hommes comme des esclaves, et quand ils ne peuvent plus travailler, de les tuer.
Le Président : Vous n’avez plus rien à déclarer ?
Mme V-C : Non.
Le Président : Je vous remercie. Si le Tribunal veut interroger le témoin, j’en ai achevé.
Général Rudenko : Je n’ai pas de question à poser.
Dr Hans Marx (Avocat, remplaçant M. Babel, avocat des SS, absent) : Le Dr Babel n’a pu venir ce matin, car il a dû se rendre à une conférence de M. le GénéralMitchell. Messieurs les Juges, je voudrais me permettre de poser au témoin quelques questions pour l’éclaircissement du sujet : Madame Couturier, vous disiez que vous aviez été arrêtée par le Police française ?
Mme V-C : Oui.
Dr Marx : Pour quel motif avez-vous été arrêtée ?
Mme V-C : Résistance. J’appartenais à un mouvement de résistance.
Dr Marx : Une autre question… Quelle était la position que vous occupiez ?
Mme V-C : Quelle position ?
Dr Marx : La position que vous occupiez ? A ce moment, aviez-vous une position quelconque ?
Mme V-C : Où ?
Dr Marx : Par exemple, étiez-vous institutrice ?
Mme V-C : Avant la guerre ? Je ne vois pas très bien ce que la question a à voir avec le sujet ? J’étais journaliste.
Dr Marx : Oui, c’est ce que je voulais dire. Dans vos déclarations, vous avez fait remarquer que vous aviez une grande habitude du style et de la parole, et c’est pourquoi je vous demandais si vous aviez occupé une position dans cette branche, si vous étiez institutrice ou si vous faisiez des conférences, par exemple ?
Mme V-C : Non, j’étais reporterphotographe.
Dr Marx : Comment pouvez-vous expliquer que vous-même ayez pu passer au travers de tout cela, et que vous soyez revenue dans un bon état de santé ?
Mme V-C : D’abord, j’ai été libérée il y a un an ; en un an de temps, on a le temps de se remettre ; ensuite, j’ai été dix mois, comme je l’ai indiqué, en quarantaine, et j’ai eu la chance de ne pas mourir du typhus exanthématique, bien que je l’aie eu et que j’aie été malade pendant trois mois et demi. D’autre part, à Ravensbrück, les derniers temps, comme je sais l’allemand, j’ai travaillé pour faire l’appel du revier et je n’avais donc pas à subir les intempéries ; mais par contre, sur 230, nous rentrons à 49 de mon transport, et nous n’étions plus que 52 au bout de 4 mois ; j’ai eu la chance de revenir.
Dr Marx : Est-ce que vos déclarations émanent de votre propre observation, ou bien s’agit-il de communications qui vous auraient été faites par d’autres personnes ?
Mme V-C : Chaque fois que c’est le cas, je l’ai signalé dans ma déclaration je n’ai jamais cité quoi que ce soit qui n’ait été vérifié aux sources et par plusieurs personnes, mais la majorité de ma déclaration porte sur un témoignage personnel.
Dr Marx : Comment pouvez-vous expliquer que vous ayez ainsi des connaissances statistiques tellement exactes ? Par exemple vous parlez de 700 000 Juifs qui seraient arrivés de Hongrie.
Mme V-C : Je vous ai dit que j’avais travaillé dans les bureaux, et en ce qui concerne Auschwitz, que j’étais amie de la secrétaire de la Oberaufseherin dont j’ai indiqué le nom et l’adresse au Tribunal.
Dr Marx : On prétend cependant qu’il y aurait 350 000 Juifs seulement venus de Hongrie, ceci d’après les indications du chef de service de la Gestapo, Eichmann.
Mme V-C : Je ne veux pas discuter avec la Gestapo. J’ai de bonnes raisons pour savoir que ce qu’elle déclare n’est pas toujours exact.
Dr Marx : Bien. Comment avez-vous été traitée vous-même ? Avez-vous été bien traitée ?
Mme V-C : Comme les autres.
Dr Marx : Comme les autres ? Vous avez dit aussi que le peuple allemand était au courant de ce qui se passait à Auschwitz ; sur quoi se base cette assertion ?
Mme V-C : Je l’ai dit, d’une part, sur le fait que lorsque nous sommes parties, les soldats lorrains de la Wehrmacht nous ont dit dans le train : « Si vous saviez où vous allez, vous ne seriez pas si pressées d’y arriver ».
D’autre part, sur le fait que les Allemandes qui sortaient de la quarantaine pour aller travailler dans des usines étaient au courant de ces faits et qu’elles disaient toutes qu’elles le raconteraient dehors.
Troisièmement sur le fait que, dans toutes les usines où travaillaient des « Haeftlinge », des détenues, elles étaient en contact avec des civils allemands, ainsi que les Aufseherinnen qui avaient des relations avec leurs familles et leurs amis et qui souvent se vantaient de ce qu’elles avaient vu.
Dr Marx : Encore une question : jusqu’en 1942, vous avez pu constater la conduite des soldats allemands à Paris. Est-ce que les soldats allemands ne se sont pas conduits d’une façon convenable, est-ce qu’ils ne payaient pas ce qu’ils réquisitionnaient.
Mme V-C : Je n’en ai pas la moindre idée ; je ne sais s’ils payaient ce qu’ils réquisitionnaient. Quant aux traitements convenables, trop des miens ont été fusillés ou massacrés pour que je puisse partager votre opinion sur cette question.
Dr Marx : Je n’ai pas d’autre question à poser au témoin.
Le Président : Si vous n’avez plus d’autre question à poser, il n’y a plus rien à dire. Il y a trop de rires dans cette salle, je l’ai déjà dit. (Au Docteur Marx) J’ai cru que vous aviez dit que vous n’aviez plus de question à poser.
Dr Marx : Je voulais simplement me permettre, au nom de l’avocat Babel, de faire la réserve qu’il voudra certainement interroger le témoin en contre-interrogatoire.
Le Président : Le Docteur Babel, dites-vous ?
Dr Marx : Oui.
Le Président : Je m’excuse, certainement, mais le Docteur Babel sera-t-il revenu ?
Dr Marx : – Je suppose qu’il sera là cet après-midi ; il est dans le Palais, mais il lui faut le temps de lire le compte-rendu.
Le Président : Nous allons considérer le fait, si le Docteur Babel est là cet après-midi, que le Docteur Babel fasse une autre demande. D’autres avocats de la Défense allemande veulentils poser des questions au témoin ? Monsieur Dubost, avez-vous d’autres questions que vous désiriez demander dans un nouvel interrogatoire ?
M. Dubost : Je n’ai plus de questions à poser, Monsieur le Président.
Le Président : Le témoin peut se retirer.
Mme Claude Vaillant-Couturier se retire..