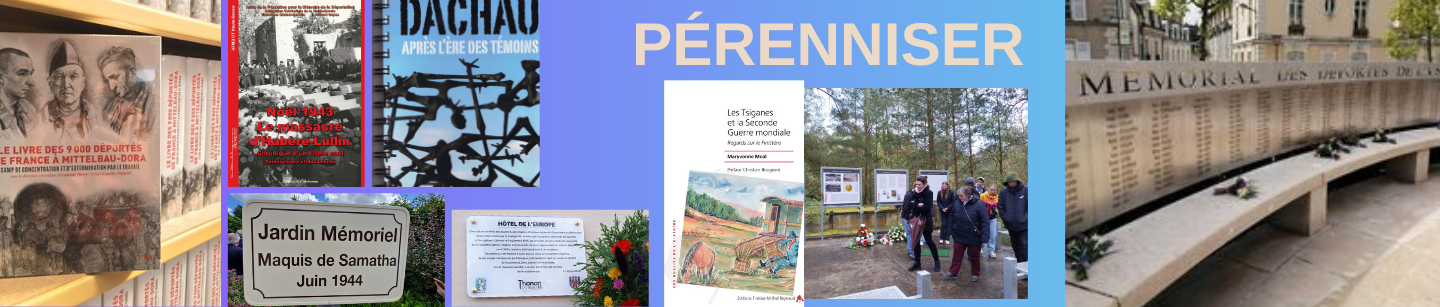Les Françaises à Auschwitz-Birkenau
Les conditions de vie au camp d’Auschwitz-Birkenau sont très différentes de celles de Ravensbrück.
D’abord, il s’agit d’un camp d’extermination de juifs et de tsiganes. La « sélection » se fait dès l’arrivée. D’un côté, ceux et celles que les SS font monter dans les cars pour être conduits directement aux chambres à gaz. De l’autre les jeunes en bonne santé, les médecins, dentistes, les personnes parlant l’allemand ou ayant une profession utile au fonctionnement du camp, sont sélectionnés comme main d’œuvre esclave. Mais une main d’œuvre assignée à des « activités absurdes, inutiles », dit Simone Veil dans son témoignage au Mémorial de la Shoah, comme de « décharger des camions avec d’énormes pierres, creuser des tranchées, aplanir le sol, avec des brouettes sans roues, transporter des pierres dans un sens puis dans l’autre, vider les latrines ». [1]
Pour manger la soupe, il faut « organiser » une cuillère en échange d’un morceau de pain. L’humiliation en permanence. Humilier les femmes en les rasant de la tête aux pieds, en les obligeant à s’atteler à des travaux de force sans manger, en les accoutrant de vêtements disparates, sales, de chaussures dépareillées et en refusant de leur donner du linge quand elles ont leur règles. Du moins, les rares qui ont encore des règles. Les nazis les marquent d’un numéro, les tatouent à l’encre bleue, les stigmatisent… Elles n’ont plus de nom.

C’est un camp immense, divisé en Lager A et B qui comprend en outre le Lager de la quarantaine et celui des hommes. Les femmes seront parquées à côté du camp principal, à Birkenau, quand il sera agrandi et que les chambres à gaz seront construites. Birkenau poura contenir jusqu’à 40.000 femmes. En 1943, on recense plus de 150.000 personnes, dont 46.000 femmes. Le nombre fluctue constamment et atteint 155.000 en août 1944.
Les gazages à Birkenau débutent en janvier 1942. Les premières femmes internées à Auschwitz-Birkenau sont 999 détenues allemandes (prisonnières de droit commun et « asociales ») qui arrivent de Ravensbrück le 26 mars 1942. Les Aryennes seront placées dans un bloc à part, le bloc 10. Jusqu’à la déportation massive des juifs en provenance de toute l’Europe, les Polonais y sont majoritaires.
Le premier convoi part de France vers Auschwitz le 27 mars 1942, suivi d’un autre le 5 juin, le 22 le 25, etc. En tout, plus de 77 convois partiront de Compiègne, Pithiviers, Beaune-La-Rolande, et Drancy jusqu’au 17 août 1944. Les Juifs en provenance de France déportés dans le but d’extermination sont au nombre de 73.853 hommes, femmes et enfants entre mars 1942 et août 1944. C’est une extermination massive, programmée, la « solution finale » puisque 2.190 seulement en reviendront, dont 740 femmes.
« Le ciel n’était jamais bleu, même en été », raconte Hélène Broda, une des cinq femmes survivantes de son convoi, dans son témoignage du Mémorial de la Shoah. Il y avait l’odeur permanente de chair brûlée. »
Il arrive que des résistants français soient dirigés vers Auschwitz. On dénombre 3.100 déportés de répression en provenance de France qui seront immatriculés à Auschwitz entre le 27 janvier 1943 et le 12 décembre 1944 . [2] Là, à la différence de Ravensbrück, « Il n’y avait qu’une punition : le block 25, la mort », écrit Charlotte Delbo.
Lors de son témoignage au procès de Nuremberg, Marie-Claude Vaillant-Couturier, déportée par le convoi du 24 janvier 1943, dira : « A Auschwitz, visiblement le but était l’extermination. On ne s’occupait pas du rendement. On était battu pour rien du tout. Il suffisait d’être debout du matin au soir, mais le fait que l’on porte une brique ou dix briques n’avait pas d’importance. On se rendait bien compte qu’on utilisait le matériel humain esclave, et pour le faire mourir, c’était cela le but ; alors qu’à Ravensbrück le rendement jouait un grand rôle. C’était un camp de triage. Quand des transports arrivaient à Ravensbrück ils étaient expédiés très rapidement, soit dans des usines de munitions, soit dans des poudreries, soit pour faire des terrains d’aviation, et les derniers temps, pour creuser des tranchées ».
Les premiers gazages (la « solution finale ») auront lieu dans la nuit du 12 au 13 mars 1943, juifs provenant du ghetto de Cracovie.
Le convoi dans lequel Marie-Claude Vaillant-Couturier est arrivée à Auschwitz comprenait un grand nombre de résistantes communistes déportées après l’entrée en guerre de l’Union Soviétique. Il y avait Charlotte Delbo, dont le livre sur ce convoi des 31.000 (les femmes seront tatouées de matricules dans la série des 31.000) recense toutes les femmes de ce transport, Danielle Casanova, qui mourra du typhus, Hélène Solomon-Langevin, Marie Politzer, en tout 239 femmes dont 49 seulement reviendront. Peut- être que ces dernières ont été sauvées grâce à une campagne politique dénonçant les conditions de détention de ces résistantes.
Les survivantes du convoi du 24 janvier seront placées en quarantaine où elles ne sont plus astreintes au travail stupide, et déportées à Ravensbrück le 4 août 1944, sous le classement NN « ce qui signifiait qu’elles n’iraient pas travailler hors du camp, qu’elles ne seraient pas envoyées en transport ».
Comme l’écrit Charlotte Delbo, « Nous n’étions pas, de loin, les seules Françaises à Birkenau, mais nous étions les seules qui y fussent sous l’étiquette « politique ». Les autres y étaient sous l’étiquette « juif ». Qu’un juif soit pris au combat, les armes à la main, ou dans une rafle, qu’importe. Pour la Gestapo, c’était un juif, jamais un politique. Les juifs n’avaient plus de nationalité ». [3]
Les juifs résistants internés à Auschwitz étaient cependant différenciés par une étoile jaune avec un triangle rouge, comme en témoigne Paul Chytelman . [4]
Marie-Claude Vaillant-Couturier raconte leur arrivée en plein hiver polonais : « Nous sommes arrivées à Auschwitz au petit jour. On a déplombé nos wagons et on nous a fait sortir à coups de crosses pour nous conduire au camp de Birkenau, qui est une dépendance du camp d’Auschwitz, dans une immense plaine qui, au mois de janvier, était glacée. Nous avons fait le trajet en tirant nos bagages. Nous sentions tellement qu’il y avait peu de chance d’en ressortir - car nous avions déjà rencontré les colonnes squelettiques qui se dirigeaient au travail - qu’en passant le porche, nous avons chanté la Marseillaise pour nous donner du courage ». [5]
Ce chant d’espoir et de combat fut entendu par une déportée qui écrivit plus tard : « De quel pays arrivent-elles. Nous guettons attentives. Soudain notre respiration s’arrête, nos poings se serrent, nos yeux brillent. Puissamment, au milieu de notre camp de mort, s’élève la Marseillaise. Pour la première fois depuis longtemps, nous respirons profondément avec un goût de liberté. Des images et des pensées se pressent dans ma tête. Je vois l’armée infinie et décidée, Les partisans, les combattants, les martyrisés, les blessés qui tombent invaincus. Des yeux hardis me regardent, des mains se tendent, et je me rend compte subitement que le monde ne finit pas avec les barbelés de notre camp, ni avec les flammes du crématoire. La vie et le monde existent. La lutte, la souffrance, l’espérance subsistent au fond des rues, dans les bunkers, dans les ponts qui sautent, dans les trains qui déraillent, dans les mains qui s’étreignent ». [6].
Pour les Juives, la « sélection » est immédiate. Odette Abadi explique qu’à l’arrivée de leur convoi, en mai 1944, « des hommes en robes rayées se sont précipités sur nous. Ils avaient de grandes cannes à leur manche recourbé. Ils nous ont jetés par terre sur le sol, tout ça en hurlant. On ne savait plus où on était, on était ébloui par le jour. Je tenais deux des gosses par la main. Il fallait avancer, les hommes d’un côté, les femmes de l’autre. J’approchais, quelqu’un a mis sa canne autour du cou “Je suis grec juif comme toi, lâche ces gosses, lâche ces gosses. Il faut que je te les fasse lâcher pour que tu vives”. Alors, naturellement, j’ai repris les mains des gosses. Il me les a arraché et je suis rentrée. Je suis passée devant les boches. Trois cents femmes sont entrées. Puis on nous a fait avancer. Je ne comprenais pas l’allemand ». “Dis que tu es médecin, on ne te rasera pas”, lui dit-on. Elles entrent sur un grand territoire de terre glaise, cinq par cinq. On les compte, recompte. Il y avait « les autres qui circulaient, qui s’embrassaient. Les nouvelles circulaient. On nous embrassait ». [7]
Odette Rosenstock-Abadi est juive résistante. Avec Moussa Abadi, médiéviste et calligraphe originaire de Salonique qu’elle épousera à son retour des camps, et Monseigneur Paul Rémond, évêque de Nice, ils ont créé le « réseau Marcel », un service clandestin pour mettre les enfants juifs à l’abri. Sous les pseudonymes de Sylvie Delattre et de Marcel, ils fabriquent de faux papiers destinés notamment aux enfants dont les parents ont été déportés. 527 enfants seront ainsi sauvés. En 1943, sa mère et sa sœur sont arrêtées et déportées à Auschwitz d’où elles ne reviendront pas. Odette est arrêtée par la Milice le 25 avril 1944, interrogée, torturée, envoyée à Drancy le 2 mai 1944, puis déportée à Birkenau le 20 mai 1944. Odette Abadi a 30 ans. Elle est médecin. A l’été 1944, elle entre au bureau des médecins, dans le centre sanitaire, tout en continuant son travail dans les Kommandos. Lorsque le centre sanitaire est supprimé, Odette devient médecin du "bloc des jumelles" et travaillera dans le block des jumelles du Revier de Birkenau, puis dans un des blocks médicaux de Bergen Belsen. Avec le livre de Fania Fénelon, celui d’Odette Abadi, Terre de détresse, écrit juste après son retour, constitue une précieuse source d’information sur les relations entre les femmes à Birkenau puis à Bergen Belsen où elle est envoyée le 1er novembre 1944. Son métier de médecin au service des malades, et une tendresse naturelle pour ses amies, lui donnent un sens aigu de l’observation empathique.
Marie-Josèphe Bonnet
Historienne
Présidente de la DT de Paris (2015-2017)
[1] S. Veil, témoignage auprès de Malka Marcovich pour la Fondation des archives audiovisuelles des survivants de la Shoah, enregistré à Paris le 7 mars 1997, cassette 5.
[2] « Dossier Auschwitz », Mémoire vivante n° 42, p. 3.
[3] C. Delbo, Le convoi du 24 janvier, Ed. de Minuit, 1965 , p. 17.
[4] P. Chytelman, Le courage d’espérer, survivre à Auschwitz et garder l’espoir, Ed. Demeter, 2005.
[5] M.-C. Vaillant-Couturier, témoignage au Tribunal de Nuremberg
[6] Texte diffusé sur France Culture en août 2006, Le tribunal de Nuremberg, la séance avec le témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier
[7] O. Abadi, Entretien avec A. Wieviorka du 22-5-1992, Mémorial de la Shoah.